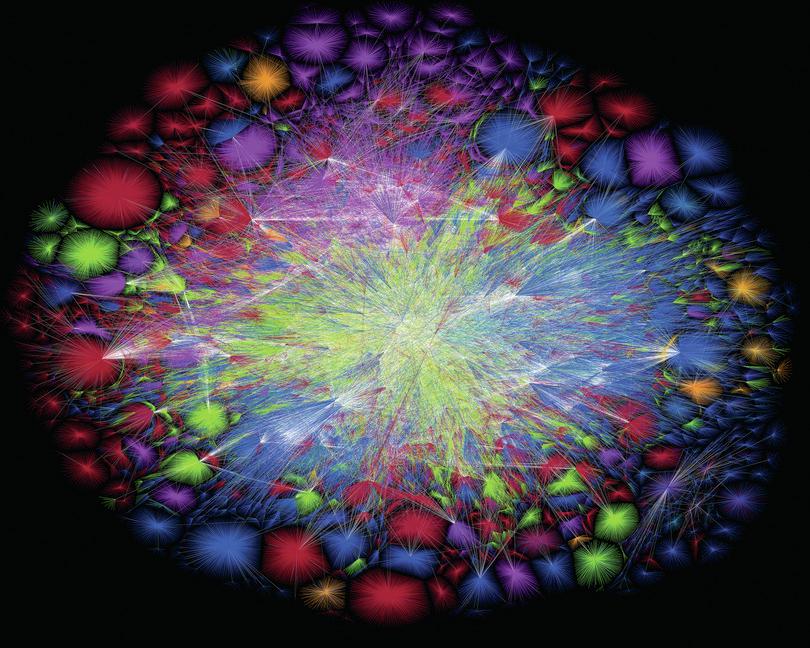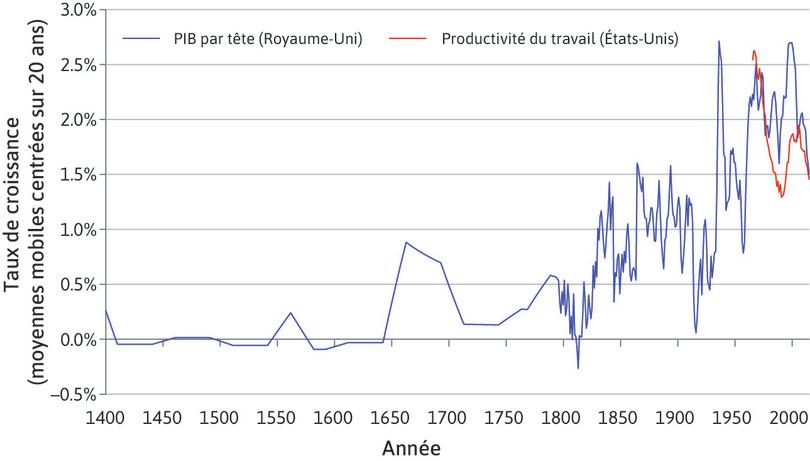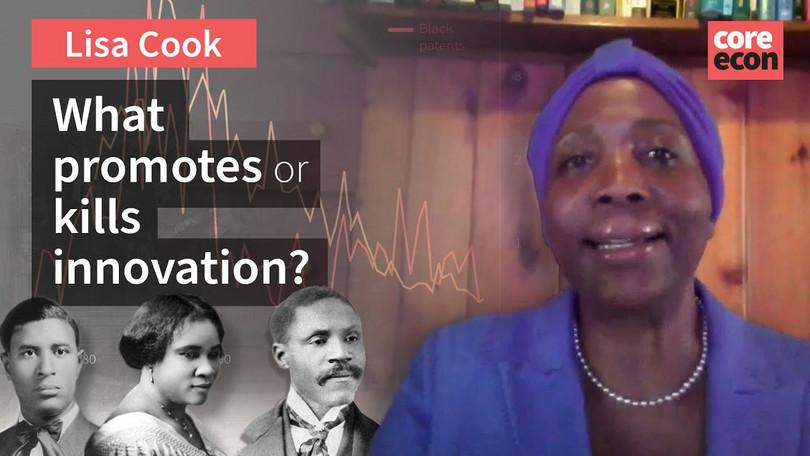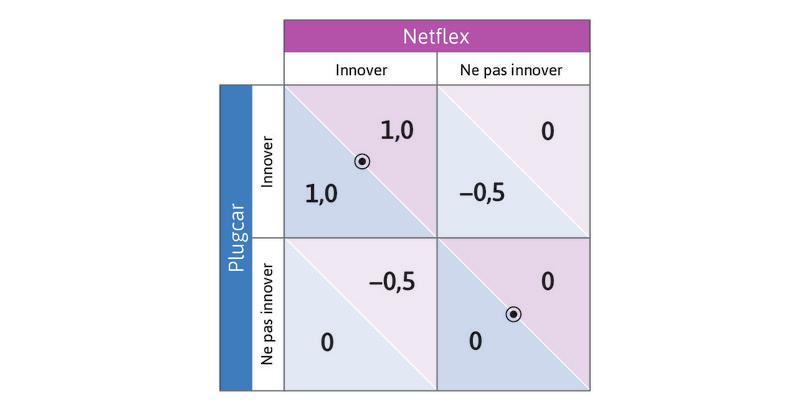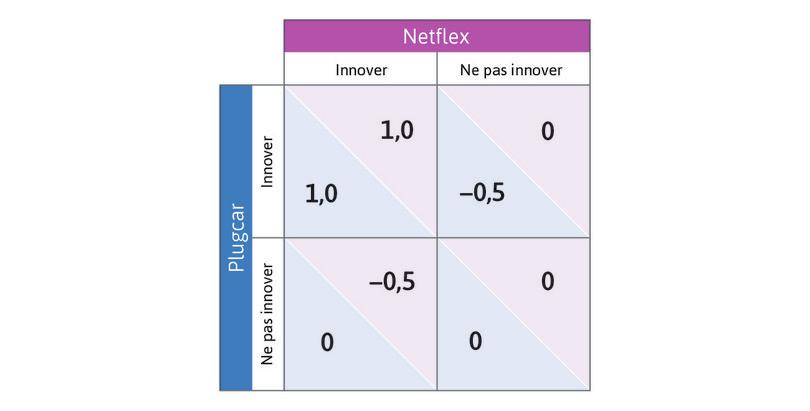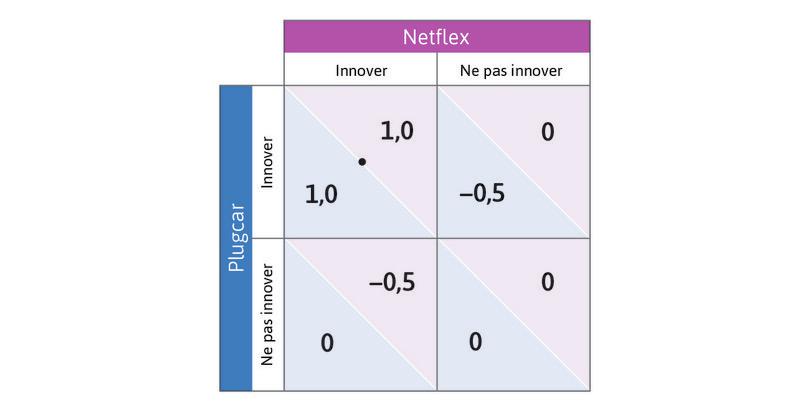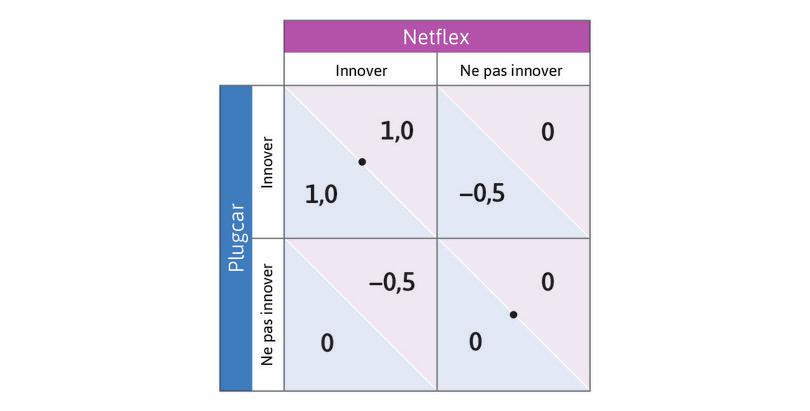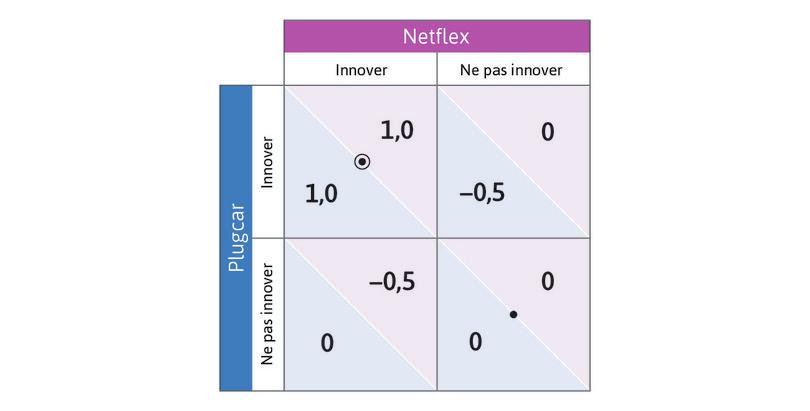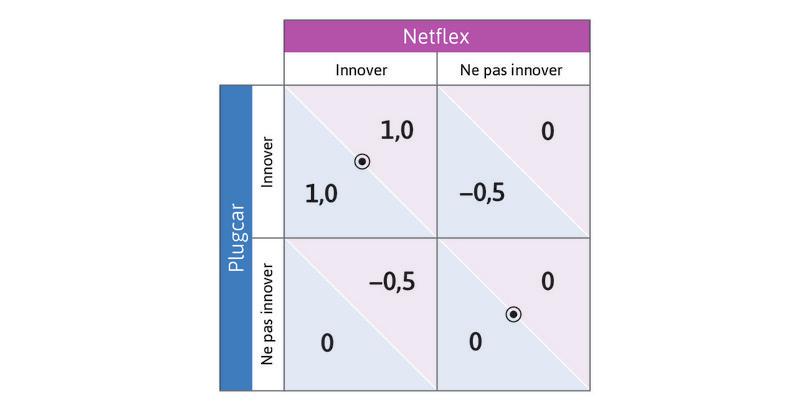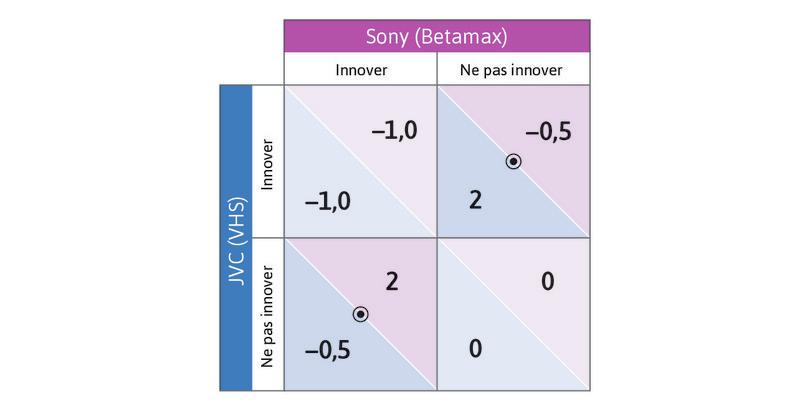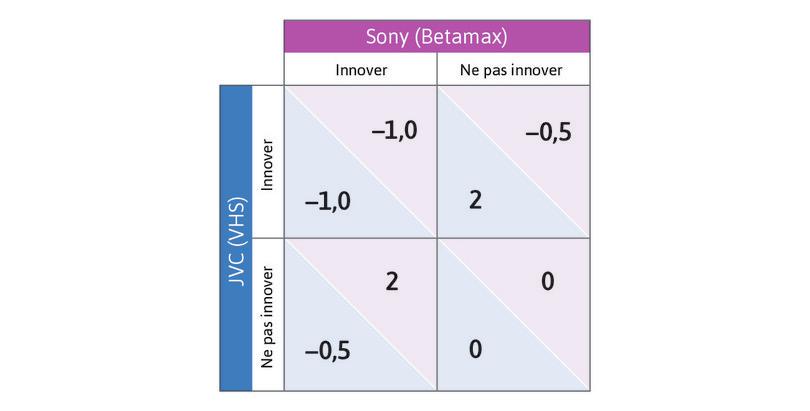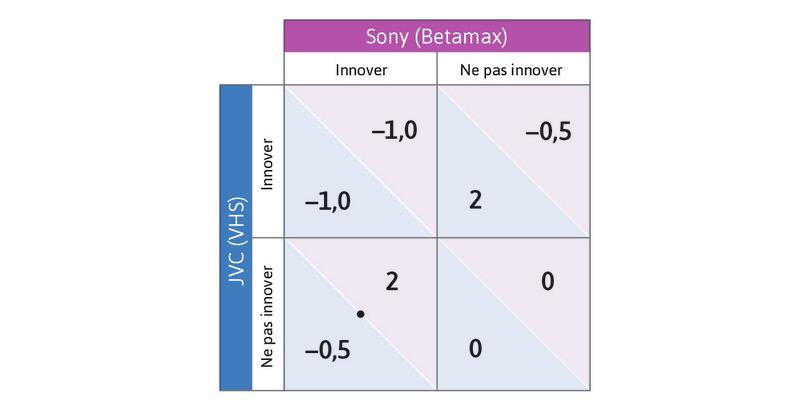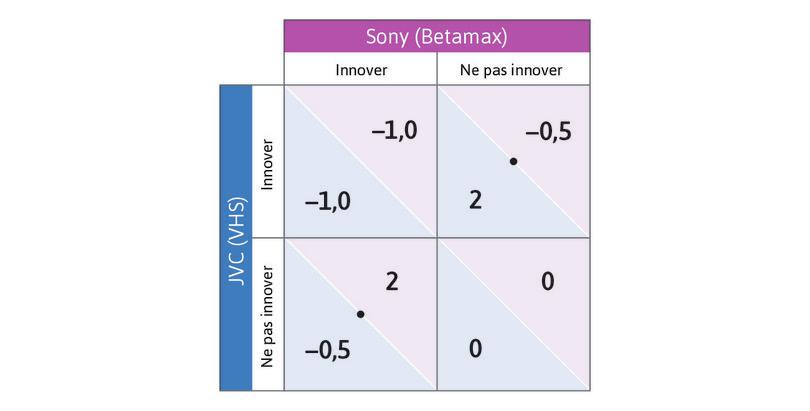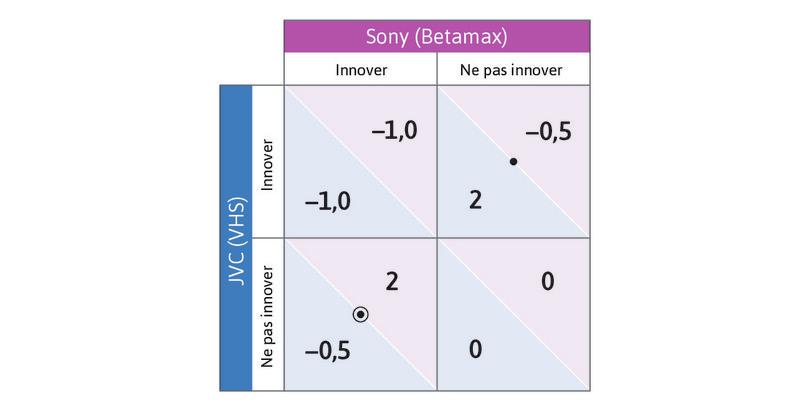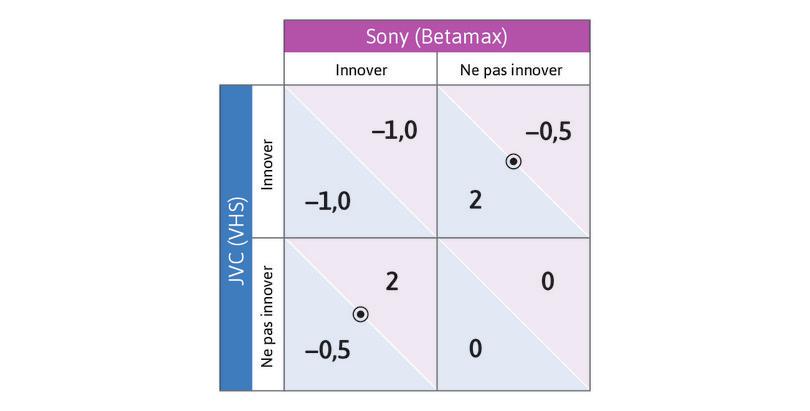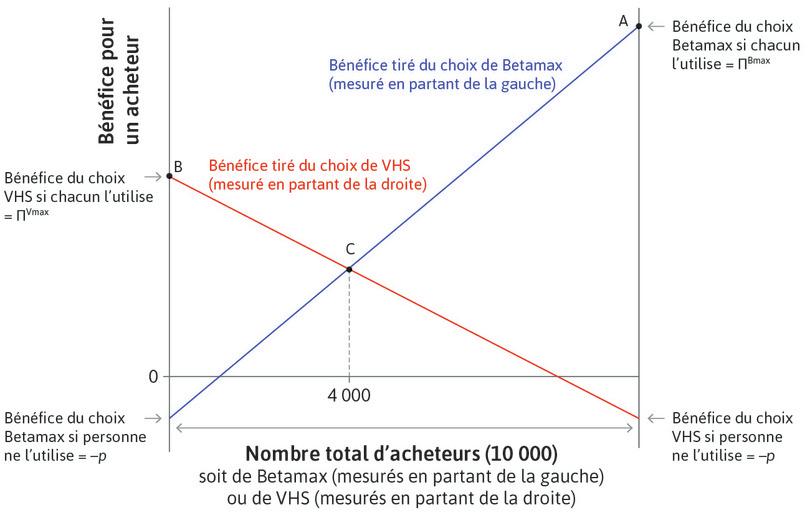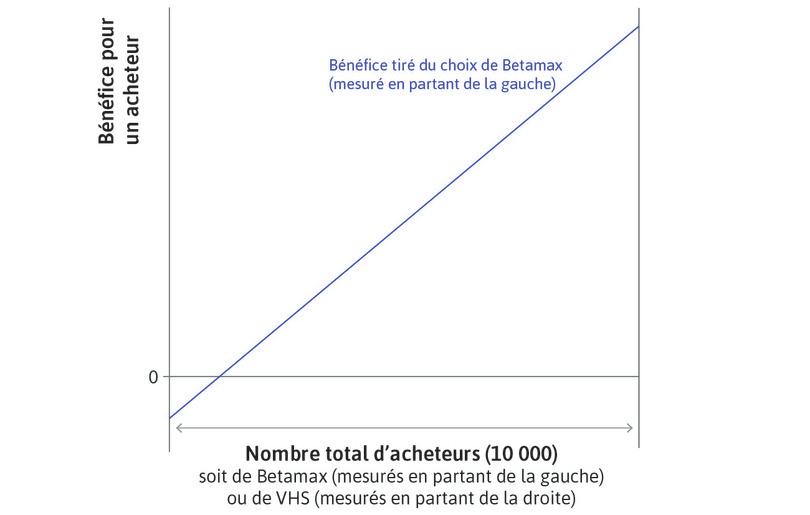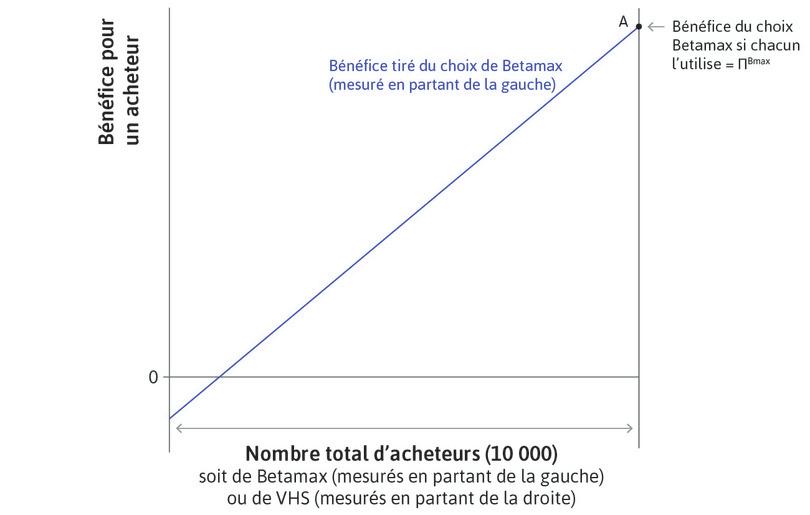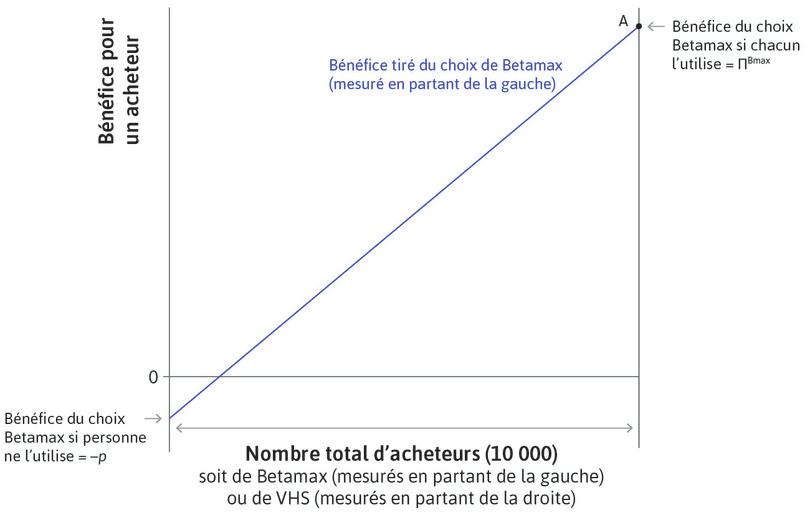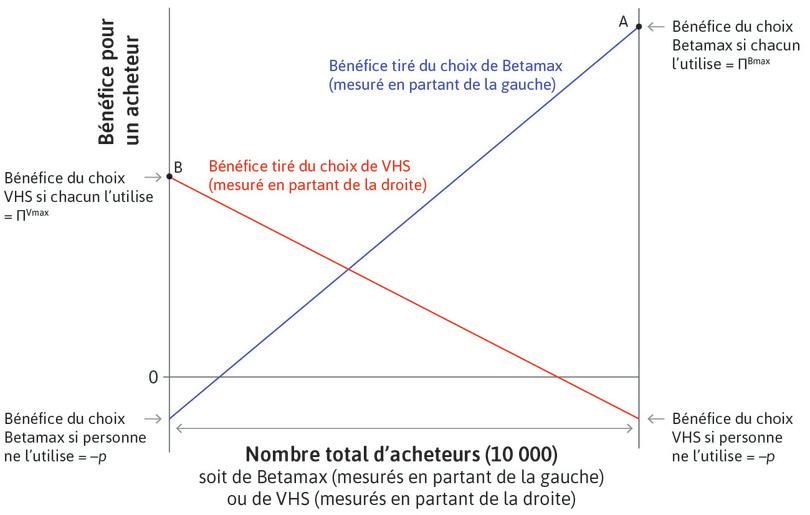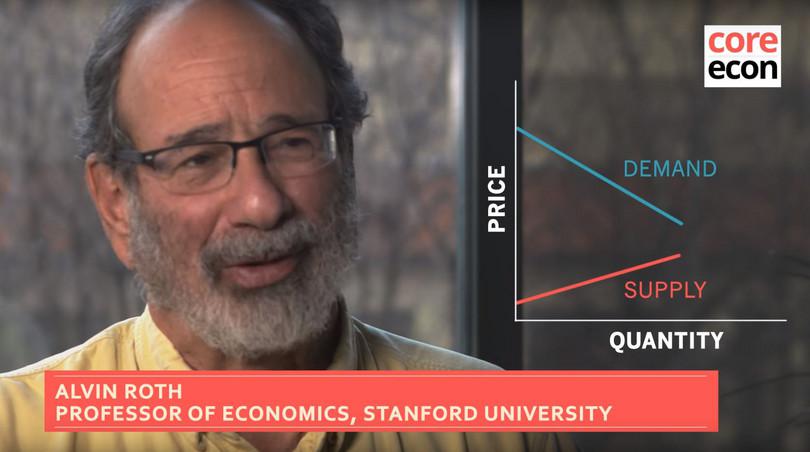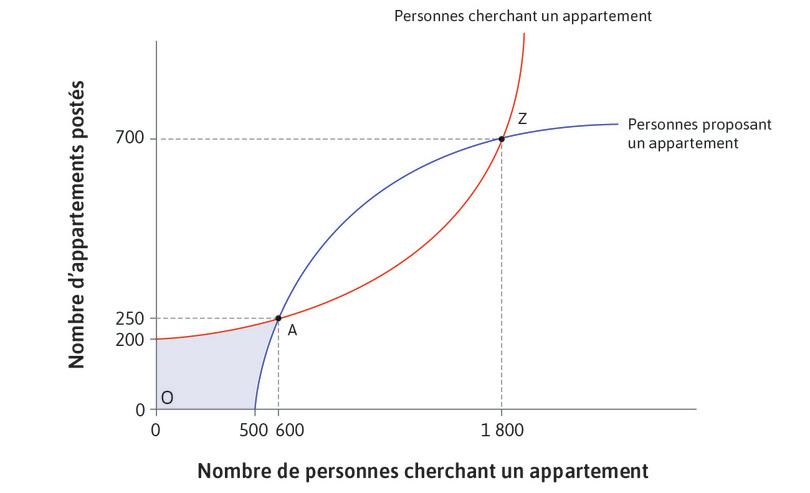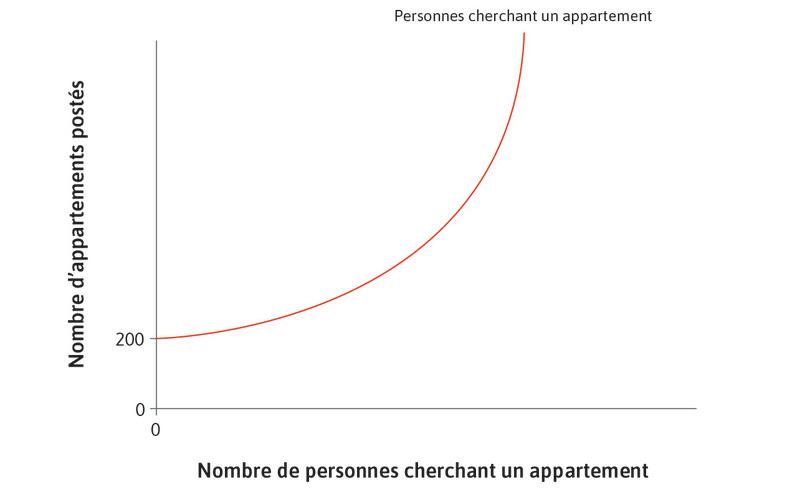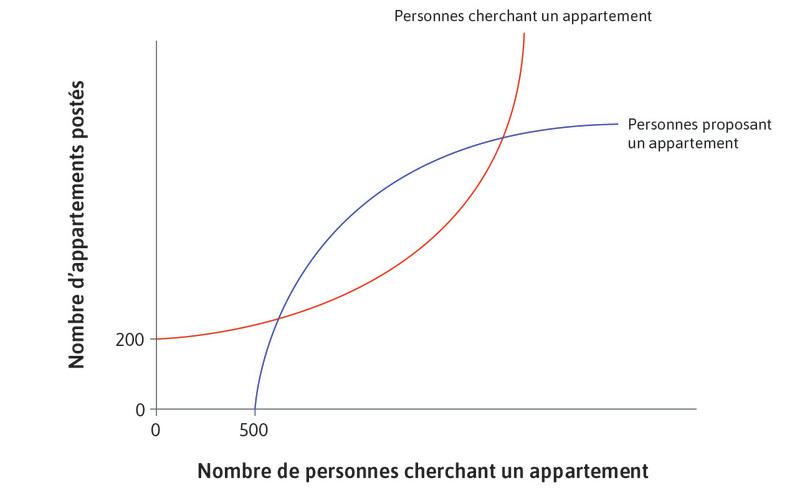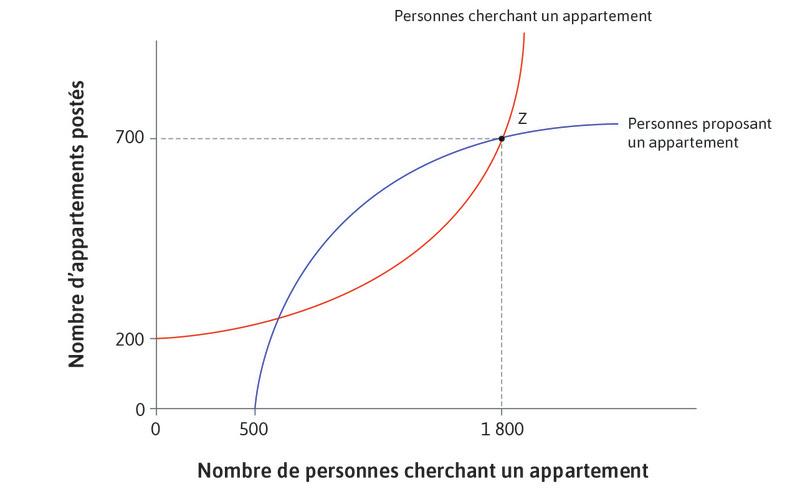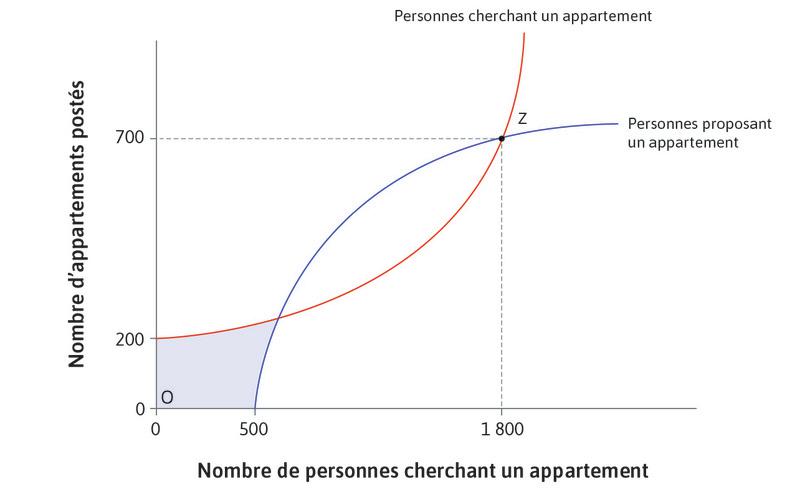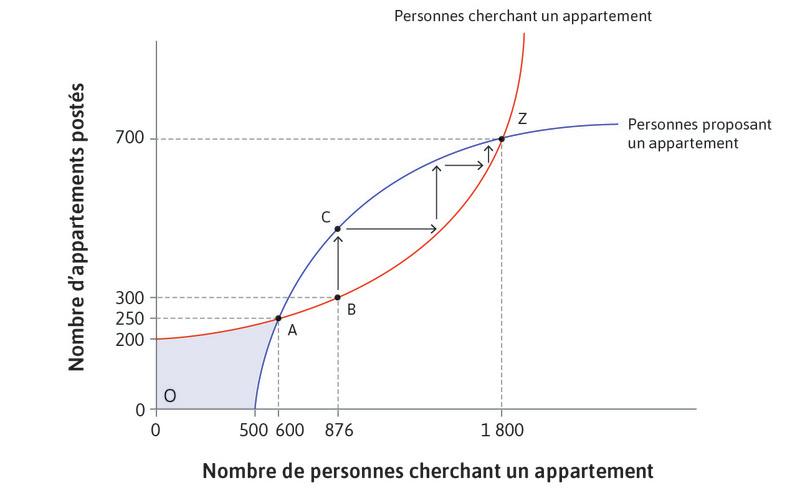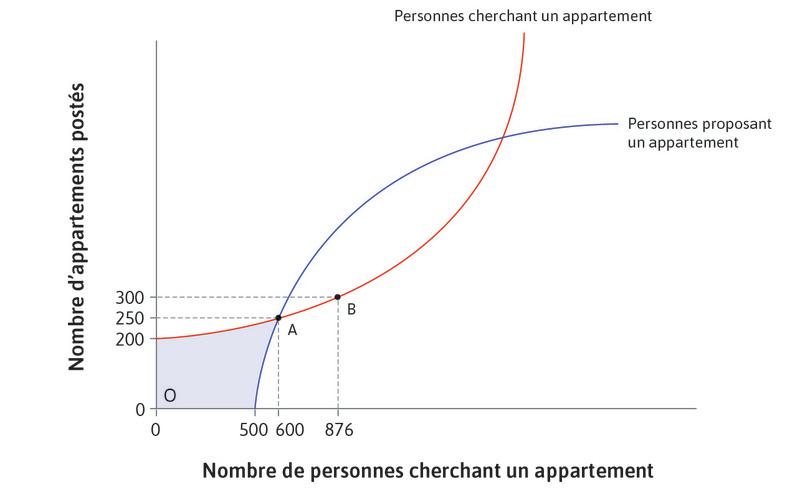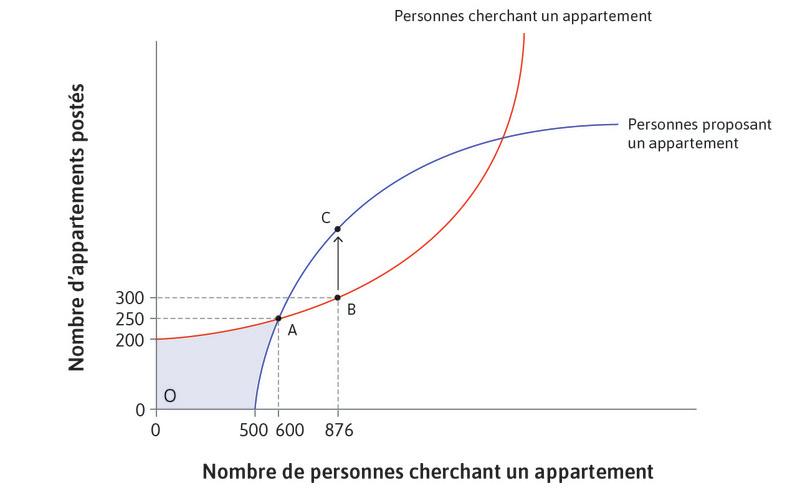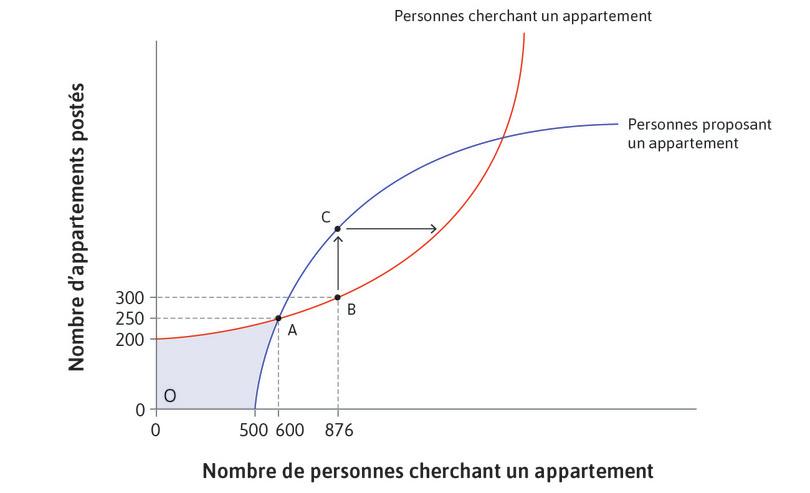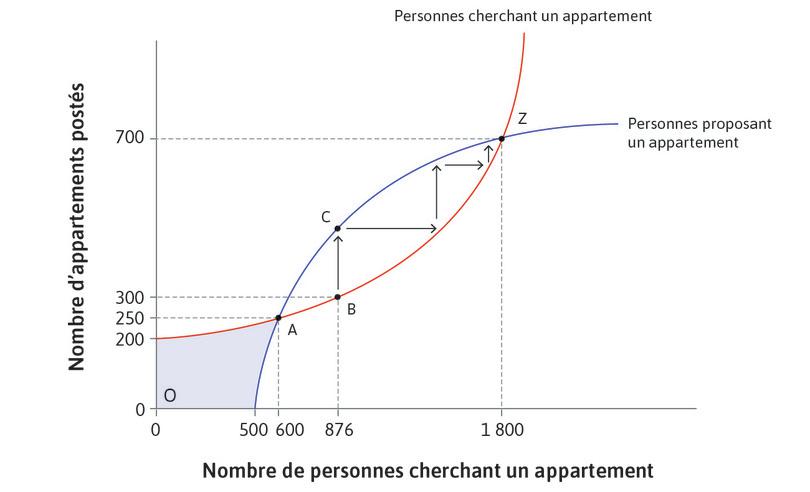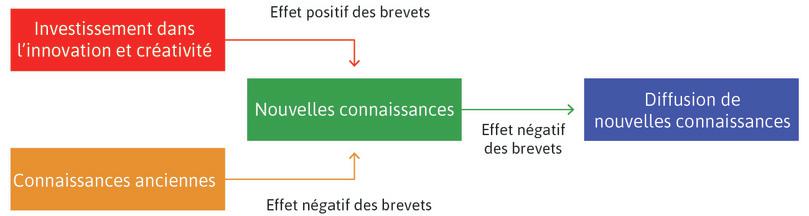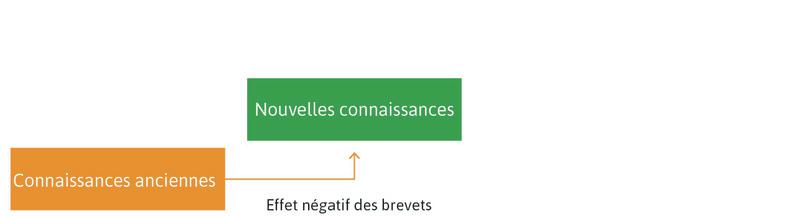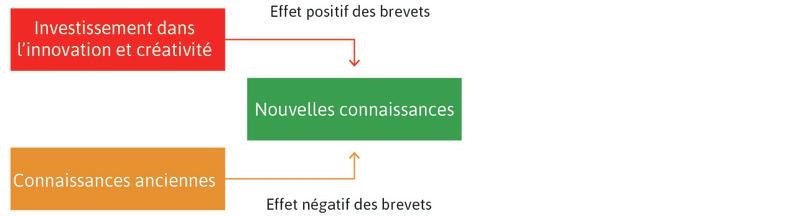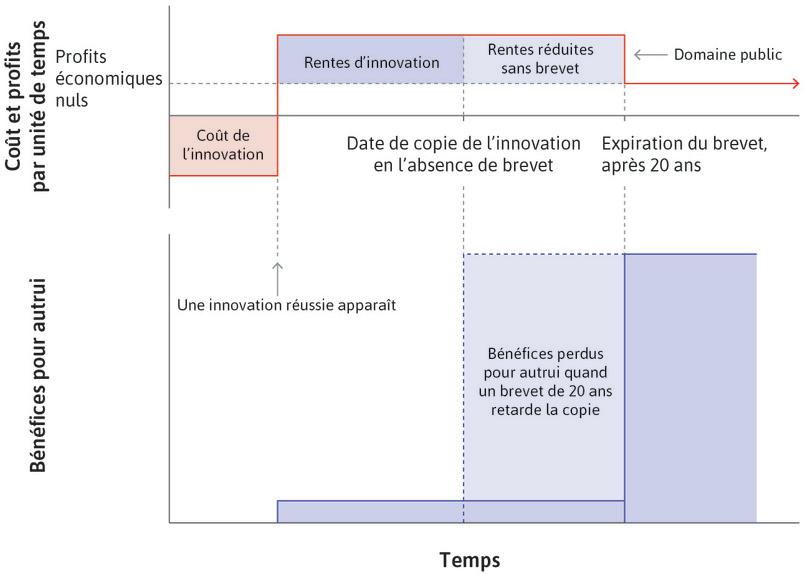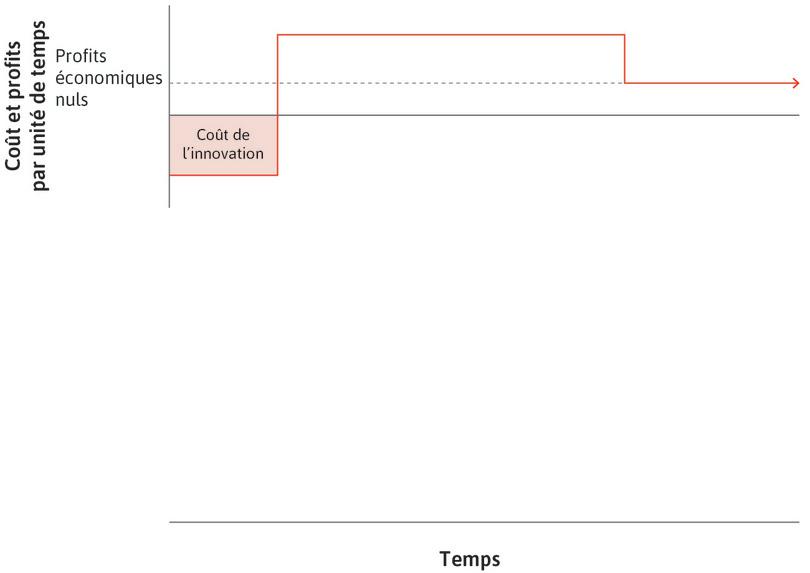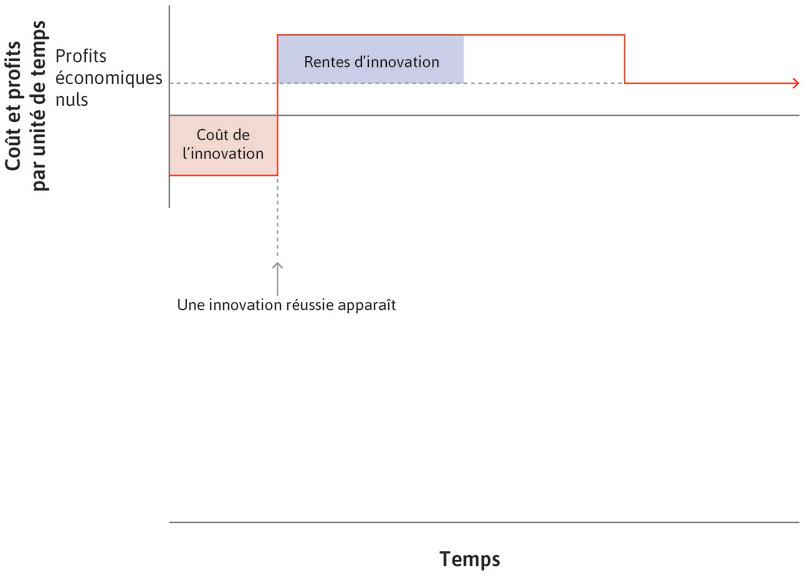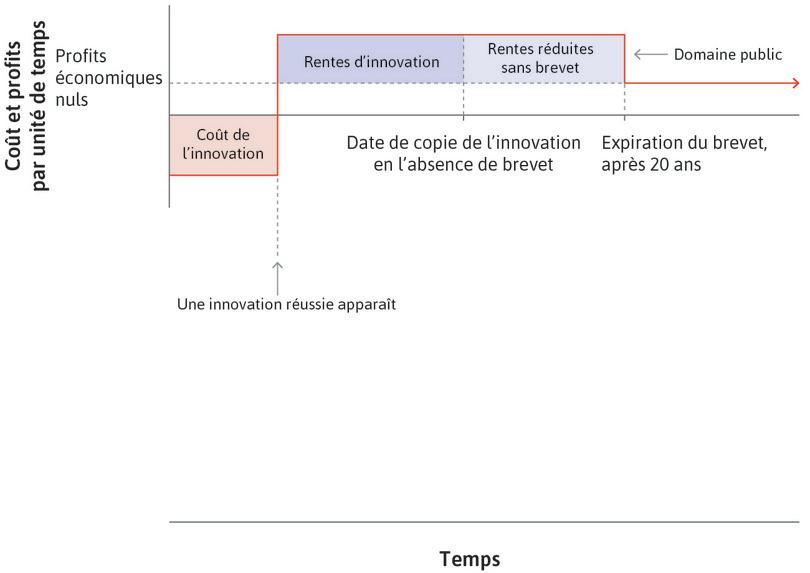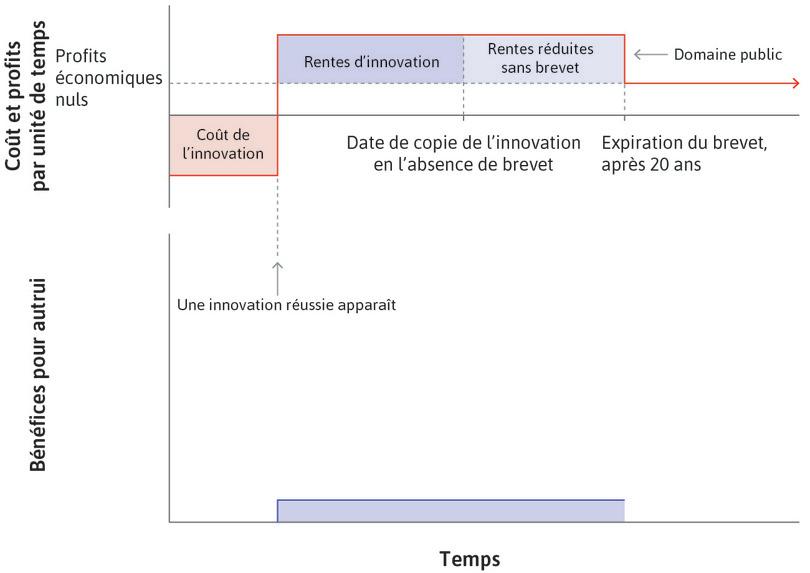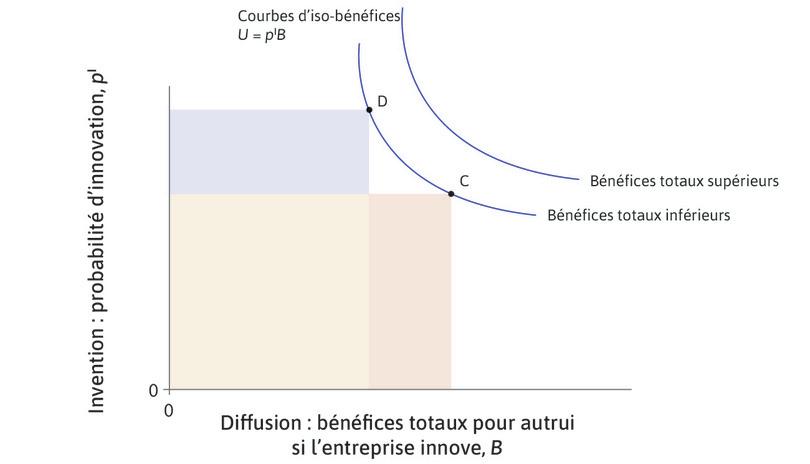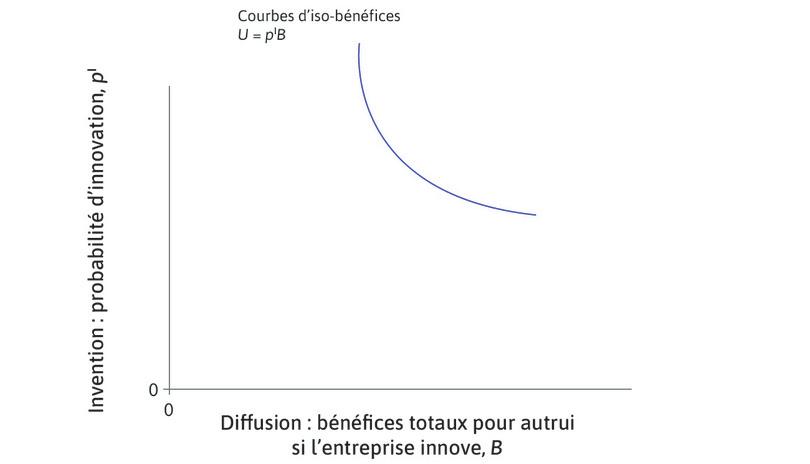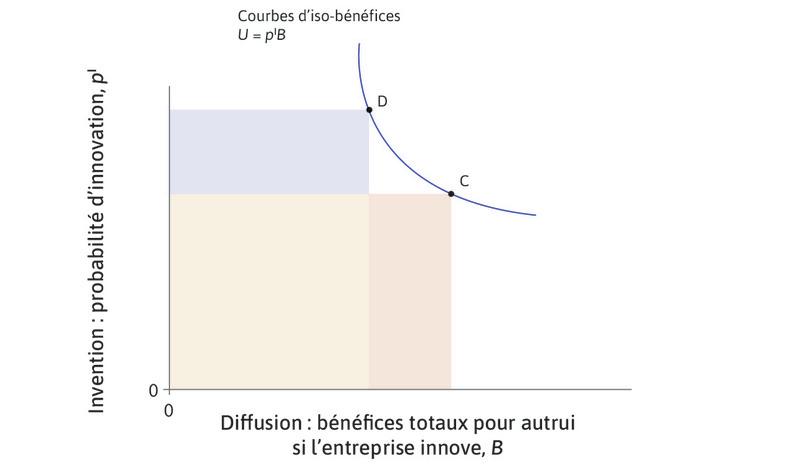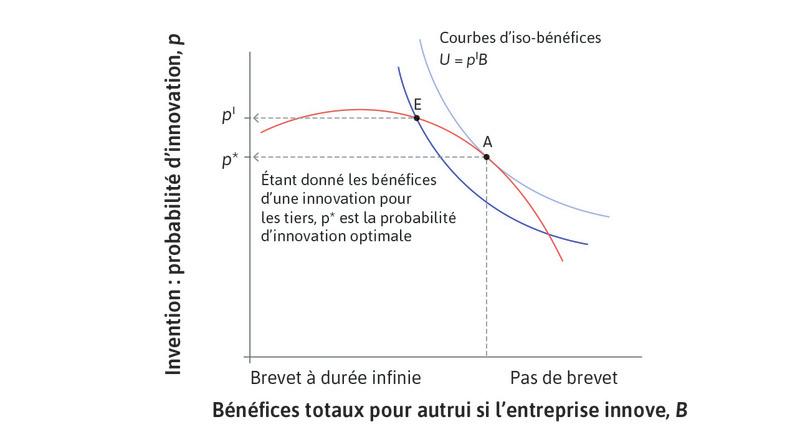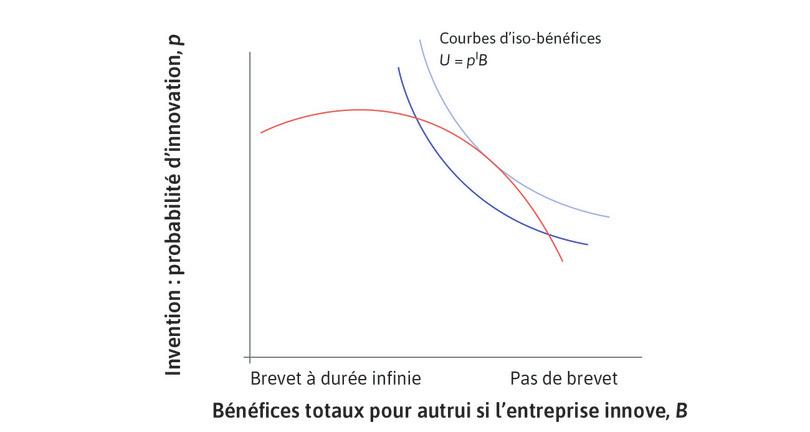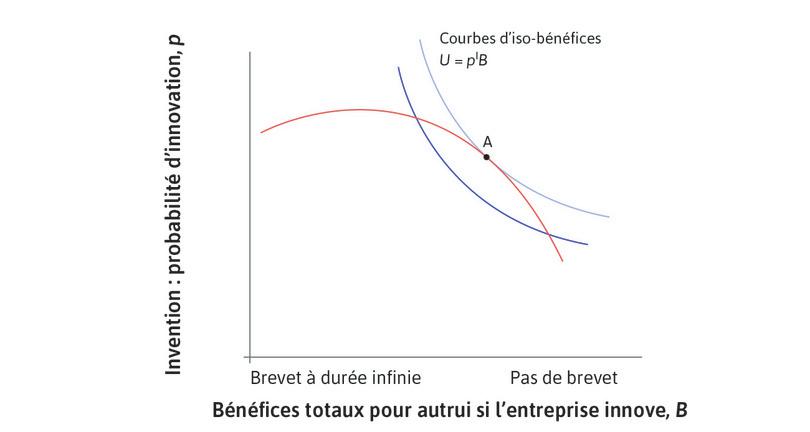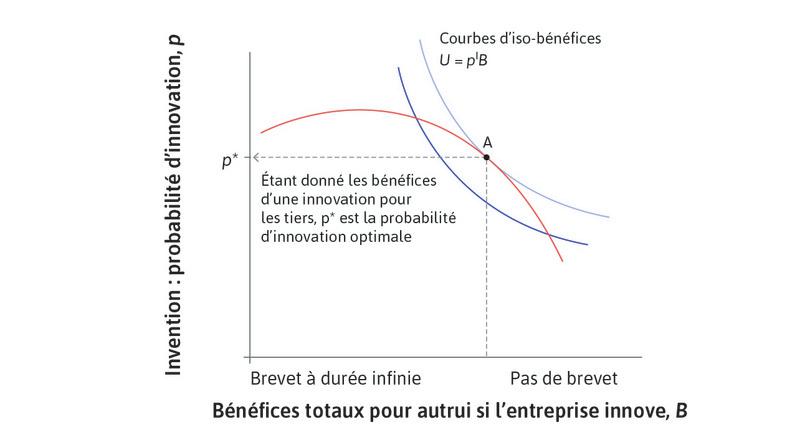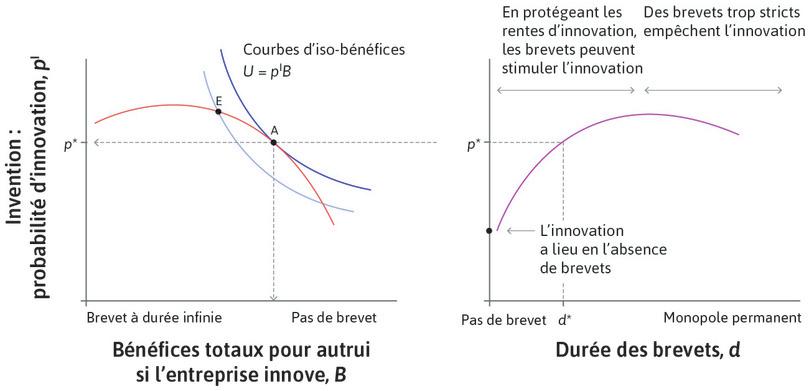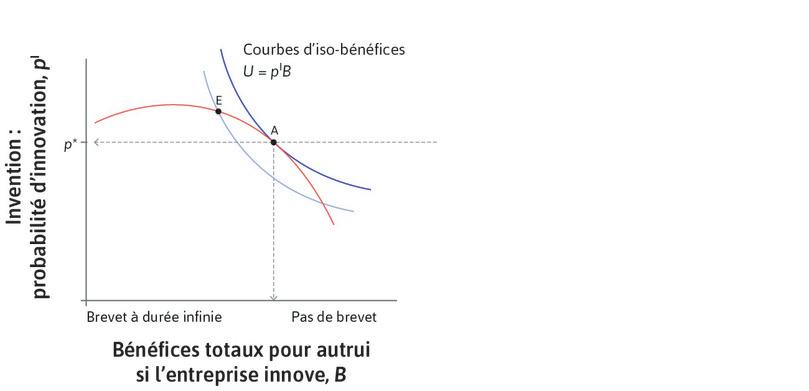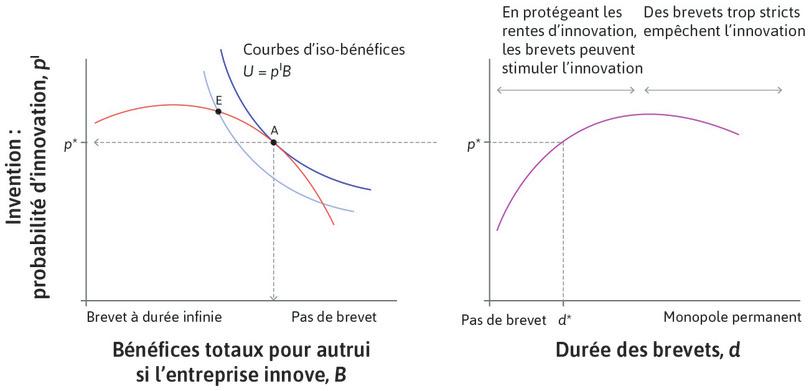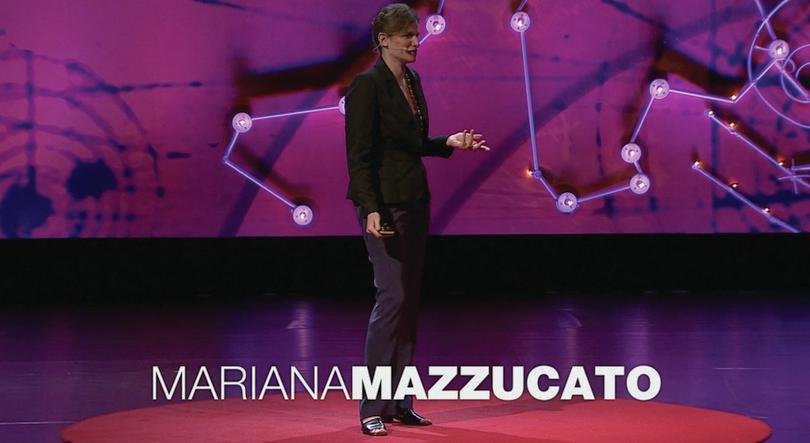Unité 21 Innovation, information et économie en réseau
Les innovations qui améliorent notre bien-être sont caractéristiques du capitalisme. Tirer le meilleur parti de la créativité et de l’inventivité humaine est un défi à relever par les politiques publiques.
- L’innovation dépend de nombreux paramètres : l’état des connaissances, la créativité individuelle, les politiques publiques, les institutions économiques et les normes sociales.
- Les individus ou entreprises qui développent des innovations bénéfiques pour la société sont récompensés par des profits excédant le coût d’opportunité du capital, appelés rentes d’innovation.
- Les rentes d’innovation sont à terme dissoutes par la concurrence d’imitateurs qui diffusent la connaissance en l’utilisant.
- La production et l’utilisation de nouvelles connaissances sont inhabituelles pour trois raisons : la connaissance est un bien non rival, produire une connaissance nouvelle est coûteux initialement, mais une fois produite, elle est facilement diffusable et utilisable gratuitement, enfin les innovations deviennent généralement plus utiles lorsque davantage de personnes les utilisent.
- Les entreprises innovantes font souvent face à peu de concurrence immédiate et peuvent engranger des profits en établissant des prix largement au-dessus des coûts marginaux de production, ce qui pénalise les consommateurs.
- Mais les entreprises innovantes ne sont pas capables de capturer tous les bénéfices des innovations qu’elles génèrent et risquent ainsi de ne pas investir suffisamment dans l’innovation.
- Les politiques publiques cherchent ainsi à diffuser les innovations bénéfiques pour la société, tout en procurant des récompenses suffisantes à ceux qui innovent.
- Partant de cet arbitrage, les droits de propriété intellectuelle peuvent être « trop stricts », empêchant les innovations d’être diffusées, ou « pas assez stricts », en ne récompensant pas assez les innovateurs.
- Les technologies du digital soutiennent des « marchés bifaces », comme Facebook, eBay ou Airbnb, qui apparient des individus qui peuvent faire des échanges mutuellement bénéfiques.
- Ces technologies ont transformé la nature de la concurrence économique, mais présentent de nombreuses défaillances de marché déjà observées dans la production de la connaissance.
À l’entrée du 21e siècle, l’Afrique du Sud avait l’un des taux d’infection au VIH les plus élevés du monde : environ 5 millions de Sud-Africains, c’est-à-dire 1 sur 10, étaient séropositifs. Pourtant, en 1998, Bristol-Myers Squib, Merck et trente-sept autres entreprises pharmaceutiques multinationales ont attaqué en justice le gouvernement sud-africain afin de l’empêcher d’importer des médicaments rétroviraux génériques (sans marque) ou peu chers, ainsi que d’autres traitements contre le SIDA, en provenance d’autres pays du monde.
Des manifestations furent organisées en Afrique du Sud, et l’Union Européenne ainsi que l’Organisation Mondiale de la Santé annoncèrent leur soutien au gouvernement sud-africain. Al Gore, alors vice-président des États-Unis, qui avait représenté les intérêts des entreprises pharmaceutiques dans les négociations avec l’Afrique du Sud, fut confronté aux militants qui scandaient alors « Gore’s greed kills! » (« la cupidité de Gore tue ! »). En septembre 1999, le gouvernement américain – auparavant le plus grand allié des entreprises pharmaceutiques – annonça qu’il n’imposerait pas de sanctions aux pays pauvres décimés par le SIDA, même si des lois américaines relatives aux brevets n’étaient pas respectées, tant que les pays concernés respectaient les traités internationaux régissant la propriété intellectuelle. Les géants pharmaceutiques persévérèrent, embauchant des armées de juristes spécialisés en droit de propriété intellectuelle pour soutenir leur cause. Ils fermèrent des usines en Afrique du Sud et annulèrent des investissements prévus.
Mais trois ans plus tard, après des millions de dollars dépensés en contentieux auxquels s’ajoute un coût encore plus élevé pour leur image, les entreprises cédèrent (payant même les frais de justice engagés par le gouvernement sud-africain). Jean-Pierre Garnier, le directeur général de GlaxoSmithKline, téléphona à Kofi Annan, secrétaire général des Nations unies, pour lui demander de trouver un accord avec Thabo Mbeki, le président de l’Afrique du Sud. « Nous ne sommes pas insensibles à l’opinion publique. C’est un facteur dans notre prise de décision », expliqua plus tard Garnier.1 2
C’était trop tard : le mal était déjà fait. « Cela fut un désastre en termes de relations publiques pour les entreprises » commenta Hemant Shah, un analyste de l’industrie. « La probabilité pour qu’une entreprise pharmaceutique poursuive un pays en développement au sujet d’un médicament vital est maintenant extrêmement faible, en raison de ce qu’elles ont appris en Afrique du Sud ».
Bien sûr, les propriétaires d’entreprises pharmaceutiques ne peuvent pas vendre un traitement contre le SIDA à un prix inférieur au coût de fabrication, tout en restant rentables sur le marché. De plus, un faible nombre des projets de recherche dans cette industrie mène à des produits qui entreront sur le marché (la recherche en 2016 estimait le taux de succès dans le secteur à à peine plus de 4 %). Les ventes d’un produit réussi doivent donc couvrir les coûts de plusieurs échecs car, bien sûr, il est impossible de prédire quels projets de recherche vont réussir.
Dans ce cas précis, les entreprises pharmaceutiques ont engagé une action en justice en Afrique du Sud pour protéger leurs brevets. Dans l’industrie pharmaceutique, le système de brevets donne à l’entreprise innovante un monopole limité dans le temps, qui lui permet de fixer un prix bien plus élevé que le coût de fabrication (parfois avec un facteur de 10) pendant les années de protection du brevet. La perspective de profits élevés donne une incitation aux entreprises à investir dans des activités de recherche et développement risquées.
En créant un monopole imposé par l’État, la protection des brevets entre souvent en conflit avec l’objectif tout aussi important de fabriquer des biens et services disponibles à leur coût marginal (souvenez-vous de l’Unité 7 : une entreprise en situation de monopole fixera un prix supérieur au coût marginal). Le prix élevé – suffisant pour couvrir les coûts de R&D, y compris les investissements sur les projets ayant échoué – signifie que beaucoup de ceux qui pourraient bénéficier d’un accès au médicament ne vont pas l’obtenir. C’est un exemple de perte sèche d’efficacité causée par les prix des monopoles étudiés dans l’Unité 7.
Les conflits entre des objectifs concurrents – dans ce cas, la production d’une nouvelle connaissance d’un côté et sa diffusion rapide de l’autre – ne peuvent pas être évités dans l’économie et sont particulièrement difficiles à résoudre quand ils concernent l’innovation, comme nous allons le voir.
Parfois pourtant, de nouvelles technologies permettent d’obtenir des résultats gagnant-gagnant.
Souvenez-vous du problème des pêcheurs et des acheteurs de poissons du Kerala que nous avions décrit au début de l’Unité 11. En retournant au port pour vendre leur pêche quotidienne de sardines aux poissonniers, les pêcheurs se rendaient souvent compte qu’il y avait une surabondance sur le marché. Le résultat était un prix élevé pour le consommateur, en moyenne, et de faibles revenus pour les pêcheurs.3 4
- loi du prix unique
- S’applique lorsqu’un bien est échangé au même prix au niveau de tous les acheteurs et vendeurs. Si le bien était vendu à des prix différents dans des lieux différents, un négociant pourrait l’acheter moins cher à un endroit et le revendre à un prix plus élevé dans un autre. Voir également : arbitrage.
Quand les pêcheurs obtinrent des téléphones portables, ils purent appeler les marchés de poissons côtiers avant de rentrer et choisirent de se rendre à celui où les prix du jour étaient les plus élevés. Les téléphones portables ont permis la mise en place de la loi du prix unique sur les marchés de poissons de Kerala, au bénéfice des pêcheurs et des consommateurs. Notez que cette situation ne fut pas totalement gagnant-gagnant. Les téléphones portables ont largement augmenté la concurrence entre les marchands qui étaient les intermédiaires entre pêcheurs et consommateurs, car un pêcheur pouvait négocier des prix plus élevés avant de choisir vers quel marché se diriger. Les marchands furent les perdants de cette innovation.
Mais les effets du téléphone portable ont été bien plus faibles dans d’autres parties du monde, comme dans l’Uttar Pradesh et dans le Rajasthan en Inde, où le manque de routes et d’infrastructures de stockage ont empêché les fermiers de tirer profit de l’information sur les différences de prix. Un petit fermier à Allahabad a remarqué que l’information sur les prix pratiqués ailleurs qu’il pouvait obtenir à partir de son téléphone n’était pas pertinente pour lui, puisqu’il n’y avait aucune route pour se rendre à l’endroit en question. Dans ce cas, l’innovation était peu utile, à cause d’un manque d’investissement public dans les infrastructures nécessaires.
De même, quand les téléphones portables sont arrivés au Niger, en Afrique de l’Ouest, les fermiers manquaient de moyens pour transporter le niébé et les autres récoltes vers des marchés alternatifs, de telle sorte que ce sont les marchands qui transportaient les biens qui ont tiré la plupart des bénéfices. Les pêcheurs n’ont pas rencontré ce problème parce que les bateaux de pêche étaient aussi des moyens de transport, ce qui leur a permis de choisir entre les marchés.
Dans cette unité, nous allons montrer comment des concepts économiques peuvent à la fois expliquer les mesures prises par le gouvernement sud-africain afin de favoriser l’accès aux traitements contre le SIDA, le conflit causé par ces politiques et les effets contrastés des téléphones portables sur les pêcheurs du Kerala et les fermiers d’autres États indiens.
Pour comprendre l’innovation, oubliez l’image de l’inventeur excentrique, isolé, créant une meilleure souricière et devenant riche, récompensé par le bénéfice de son inspiration pour la société. L’innovation n’est pas un événement ponctuel causé par un éclair de génie. Pensez plutôt que :
- L’innovation est un processus : c’est une source fondamentale de changement dans nos vies, elles-mêmes en changement constant.
- L’innovation est aussi systémique : elle connecte des réseaux d’usagers, d’entreprises privées, d’individus et d’organismes publics.
Dans les deux prochaines sections, nous étudierons l’innovation comme processus et comme système.
Exercice 21.1 Brevets et innovation dans l’industrie pharmaceutique
- Selon Scherer dans la vidéo « Économiste en Action » , quelles sont les caractéristiques fondamentales du marché pharmaceutique qui le distinguent des autres marchés ?
- D’après la vidéo, qu’est-ce qui empêchait de rendre accessible le même médicament aussi bien dans les pays riches que dans les pays pauvres et comment ce problème a-t-il été résolu ?
21.1 Le processus d’innovation : invention et diffusion
- innovation
- Le processus d’invention et de diffusion dans son ensemble.
- invention
- Le développement de nouvelles méthodes de production et de nouveaux produits.
- diffusion
- La diffusion de l’invention dans l’économie. Voir également : écart de diffusion.
- innovation de procédé
- Une innovation qui permet à un bien ou service d’être produit à un coût moins élevé que ses concurrents.
- innovation de produit
- Une innovation qui produit un nouveau bien ou service à un coût qui attirera des acheteurs.
Commençons par quelques nouveaux termes. Nous utilisons le mot innovation pour désigner aussi bien le développement de nouvelles méthodes de production et de nouveaux produits (invention) que la diffusion de l’invention dans l’économie (diffusion). Une entreprise innovante peut produire un bien ou un service à un coût plus faible que ses concurrents ou un nouveau bien à un coût qui attirera les acheteurs. Le premier est appelé une innovation de procédé, le second une innovation de produit.
Invention et innovation
Le terme descriptif invention est parfois réservé aux découvertes majeures, mais nous l’utilisons pour désigner :
L’innovation radicale
L’innovation radicale introduit une technologie ou une idée entièrement nouvelle, qui n’était pas disponible jusqu’à présent. L’invention de la lampe à incandescence (produisant de la lumière en faisant passer de l’électricité dans un filament) a été une avancée majeure par rapport à la lumière produite en brûlant de l’huile ou du kérosène. Le format MP3 a permis la compression de la musique de manière à permettre un stockage facile sur des disques durs et de la transmettre via Internet, offrant ainsi une manière sensiblement différente des CD ou vinyles de stocker de la musique.
L’innovation incrémentale
Elle améliore un produit ou procédé existant, de manière cumulative. Après qu’Edison et Swan eurent breveté leurs conceptions des ampoules à lampe incandescente en 1880 et commencé à travailler ensemble en 1883, les améliorations successives du filament générant la lumière ont été des innovations incrémentales dans l’éclairage. Vous avez déjà découvert l’amélioration incrémentale de la machine à tisser (spinning jenny) – l’une des inventions majeures de la Révolution industrielle – dotée initialement de seulement huit broches pour finir par en avoir plusieurs centaines.5 6
Dans les précédentes unités, vous avez déjà étudié plusieurs des concepts utiles à l’étude de l’innovation. Ils sont répertoriés dans la Figure 21.1 et vous les rencontrerez de nouveau tout au long de cette unité. Avant de continuer, assurez-vous de comprendre ces concepts.
| Concepts | Dans les unités précédentes |
|---|---|
| Rentes d’innovation | 1, 2 |
| Externalités et bien publics | 4, 12 |
| Interactions stratégiques | 4, 5, 6 |
| Droits de propriété (incluant la propriété intellectuelle) | 1, 2, 5, 12 |
| Économies d’échelle | 7 |
| Compléments et substituts | 7, 16 |
| Gains mutuels et conflits sur leur répartition | 5 |
| Destruction créatrice | 2, 16 |
| Institutions et normes sociales | 4, 5, 16 |
Figure 21.1 Concepts relatifs à l’innovation déjà étudiés.
- rentes d’innovation
- Surplus de profits par rapport au coût d’opportunité du capital qu’un innovateur génère en introduisant une nouvelle technologie, structure organisationnelle ou stratégie de marketing. Connu également sous le terme : rentes schumpétériennes.
Rappelez vous que, d’après l’Unité 2, au prix en vigueur, une entreprise qui introduit une innovation réussie obtient un profit supérieur à celui des autres entreprises, c’est ce qu’on appelle une rente d’innovation. Sur la Figure 21.2, on a représenté les coûts de recherche, de développement et de déploiement d’une innovation ainsi que la rente d’innovation (profits supérieurs au coût d’opportunité du capital) associée à une même invention fructueuse.
Diffusion
La perspective de ces rentes d’innovation entraîne d’autres acteurs à essayer de copier l’invention. S’ils réussissent, les rentes d’innovation temporaires finissent par être dissoutes par la concurrence. À l’issue du processus d’imitation, l’innovateur initial reçoit uniquement de quoi couvrir le coût d’opportunité du capital, ramenant les profits économiques à zéro.
Les derniers arrivés peuvent aussi être poussés à adopter l’innovation car les prix plus faibles qui résultent d’une large adoption des nouvelles méthodes menacent de faillite ceux qui conservent l’ancienne technologie. Une entreprise qui n’innove pas fera des profits économiques négatifs, c’est-à-dire que ses recettes ne seront pas suffisantes pour couvrir le coût d’opportunité du capital. La carotte et le bâton, à travers la promesse de rentes d’innovation et la menace de faillite si l’entreprise échoue face aux autres innovateurs, se sont révélés être une force puissante pour réduire la quantité de travail nécessaire à la production des biens et services, augmentant ainsi nos niveaux de vie.
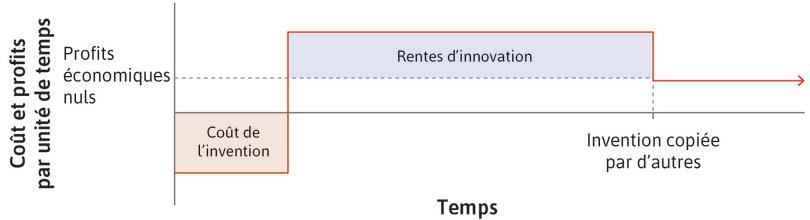
Figure 21.2 Coûts et rentes associés à l’innovation.
- technologies à usage général
- Avancées technologiques ayant des applications à de nombreux secteurs, qui peuvent rapidement être améliorées et engendrent d’autres innovations. Les technologies de l’information et de la communication (TIC) et l’électricité sont deux exemples classiques.
Bien qu’il y ait eu des inventions tout au long de l’Histoire, l’accélération du processus d’innovation a commencé en Angleterre vers 1750 (comme nous l’avons vu dans l’Unité 2), avec de nouvelles technologies majeures introduites dans le textile, l’énergie et les transports. Cela ne s’est pas arrêté avec la Révolution industrielle. De nouvelles technologies importantes ayant des applications dans de nombreuses industries, telles que la machine à vapeur, l’électricité et les transports (canaux, chemins de fer, automobiles, avions), sont appelées technologies à usage général.
William Nordhaus, un économiste dont l’analyse du taux d’actualisation appliqué aux problèmes environnementaux vous a été présentée dans l’Unité 20, a estimé la vitesse de calcul en utilisant un indice prenant la valeur 1 pour la vitesse de calcul à la main (comme diviser un nombre par un autre). Par exemple, en 1920, un maître japonais utilisant un abaque pouvait réaliser des calculs 4,5 fois plus rapidement que ne pouvait le faire à la main une personne compétente en mathématiques. Cette différence a probablement été constante pendant des siècles, car l’abaque est un instrument de calcul ancien.
Cependant, aux alentours de 1940, la vitesse de calcul s’est envolée. L’IBM 1130 introduit en 1965 était 4 520 fois plus rapide que le calcul à la main (et comme vous pouvez le voir, il est en dessous de la droite de régression pour les données à partir de 1920).
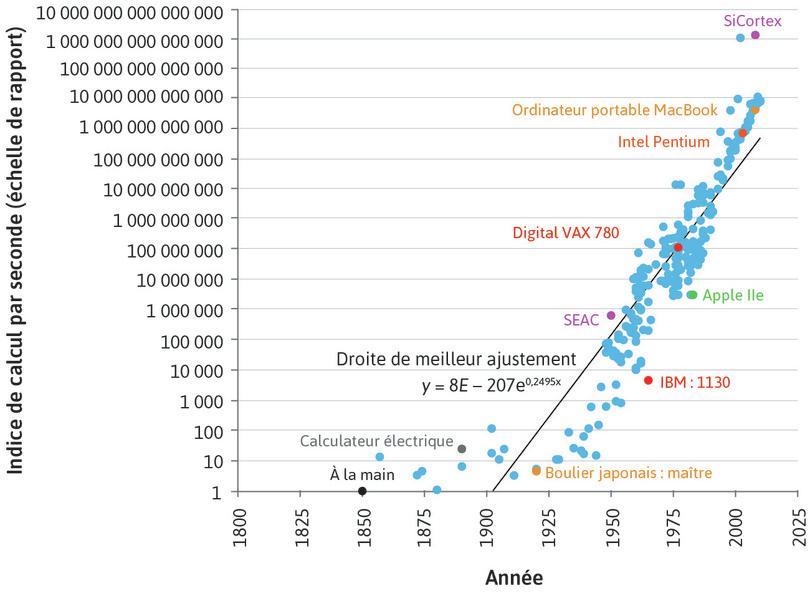
Figure 21.3 Innovation en puissance de calcul : indice de vitesse de calcul. Certains exemples spécifiques sont indiqués en couleur et labellisés.
William D. Nordhaus. 2007. ‘Two Centuries of Productivity Growth in Computing’. The Journal of Economic History 67 (01), Indice mis à jour en 2010.
- système d’innovation
- Les relations entre les entreprises privées, les gouvernements, les institutions éducatives, les scientifiques individuels et les autres acteurs impliqués dans l’invention, la modification et la diffusion de nouvelles technologies, et la façon dont ces interactions sociales sont régies par une combinaison de lois, de politiques publiques, de connaissances et de normes sociales en vigueur.
L’entrée la plus récente sur la Figure 21.3, le super-ordinateur SiCortex, réalise un milliard de calculs à la seconde. C’est plus qu’un quadrillion (comptez les zéros) de fois plus rapide que vous et c’est bien au-dessus de la droite de régression pour les données à partir de 1920 : le processus ne semble donc pas ralentir.
Mais comme l’encadré « Quand les économistes ne sont pas d’accord » l’indique, les ingénieurs et les économistes ne sont pas d’accord sur le fait de savoir si les améliorations de calcul ou d’autres technologies vont se poursuivre à la vitesse donnée par le graphique de Nordhaus ou si elles vont retourner au rythme plus modeste qui a prévalu sur une bien plus longue période.7
La ligne discontinue sur la Figure 21.2 illustre une théorie simple de l’innovation et de la diffusion du progrès technique. Elle éclaire la manière dont les rentes d’innovation, les coûts d’innovation et la copie d’innovations sont reliés du point de vue de l’entreprise ou de l’individu qui veut développer un nouveau produit ou procédé.
Pour comprendre ce processus, nous devons comprendre les déterminants des inventions, la manière dont les coûts et les rentes sont fixés et le moment auquel le processus de copie prend place. Il nous faut donc aller au-delà du point de vue de l’entreprise unique de la Figure 21.2, et envisager l’innovation comme le résultat d’interactions entre les entreprises, l’État, les institutions éducatives et beaucoup d’autres acteurs présents au sein du système d’innovation.
Quand les économistes ne sont pas d’accord La fin de la révolution technologique permanente ?
Nous avons commencé l’Unité 1 avec la Révolution industrielle, la révolution capitaliste et la crosse de hockey de l’histoire montrant le progrès technologique rapide. Dans l’Unité 2, nous avons expliqué comment ces avancées se sont traduites par des améliorations du bien-être. Et nous venons de voir la vitesse impressionnante (et potentiellement même croissante) à laquelle les technologies de calcul ont évolué.
Dans l’Unité 16, nous avons étudié la tendance de long terme de l’économie à produire davantage de services par rapport aux biens. Si la productivité dans les services croît plus lentement que la productivité industrielle, la transition des biens vers les services réduit la croissance de la productivité globale dans l’économie.
Cela va-t-il limiter la capacité du progrès technique à augmenter la productivité du travail au rythme qui a prévalu depuis la Révolution industrielle et en particulier pendant l’Âge d’or du capitalisme ? Il semble pertinent de commencer cette unité par le désaccord des économistes s’agissant de la fin de la révolution technologique « permanente ».
![Taux de croissance de la productivité sur le long terme (1400–2013)]()
Figure 21.4 Taux de croissance de la productivité sur le long terme (1400–2013).
Jutta Bolt and Jan Juiten van Zanden. 2013. ‘The First Update of the Maddison Project Re-Estimating Growth Before 1820.’ Maddison-Project Working Paper WP-4, January. Broadberry, Stephen. 2013. ‘Accounting for the Great Divergence.’ London School of Economics and Political Science. The Conference Board. 2015. Total Economy Database..
La Figure 21.4 présente les meilleures données disponibles sur les progrès de la productivité du travail au Royaume-Uni depuis 1400 et également aux États-Unis pour la période durant laquelle les États-Unis étaient le leader mondial dans le domaine technologique. Robert Gordon, un économiste spécialiste de la croissance et de la productivité, a beaucoup écrit sur la croissance de la productivité et ses effets, en particulier dans le premier chapitre de son livre The Rise and Fall of American Growth. Il mit en évidence le déclin du taux de croissance de la productivité à la fin de la période présentée sur le graphique.
Gordon pense que la période de croissance rapide de la première moitié du 20e siècle est révolue et qu’une croissance plus faible nous attend. Au contraire, Erik Brynjolfsson et Andrew McAfee, tous deux économistes, affirment que la technologie numérique marque le commencement d’un « deuxième âge des machines ». Dans une vidéo de la télévision suisse et sa seconde partie, ils présentent leur point de vue.
Exercice 21.2 La révolution technologique permanente
Utilisez toutes les sources ci-dessous, ainsi que l’article du New York Times de Thomas Edsall (« Boom or Gloom ») et celui de Lee Koromoki dans le PBS Newshour « Are the best days of the U.S. economy over » pour répondre aux questions suivantes :
- Selon Gordon, Brynjolfsson et McAfee, quels sont les facteurs autres que l’innovation technologique qui ont un effet sur le taux de croissance du PIB par tête ? Pour quelle raison les innovations d’aujourd’hui pourraient prendre du temps pour se traduire sur le taux de croissance de l’économie ?
- Évaluez dans quelle mesure la croissance du PIB par tête mesure l’effet de l’innovation ? Suggérez d’autres approches pour mesurer les effets de l’innovation.
- Selon Brynjolfsson et McAfee, comment le progrès technologique affecte-t-il les inégalités ? Utilisez les données et modèles des Unités 16 et 19 pour établir si vous êtes d’accord avec l’analyse par Brynjolfsson et McAfeee de la relation entre progrès technique et inégalités.
- Dans cette unité, nous discutons comment les politiques publiques et les institutions peuvent aider le processus d’innovation. Comment les politiques publiques et les institutions peuvent-elles aussi aider l’économie à s’ajuster aux effets de l’innovation ?
Question 21.1 Choisissez la ou les bonnes réponses
Laquelle de ces affirmations concernant l’innovation est correcte ?
- La diffusion de l’invention fait aussi partie de l’innovation.
- Il s’agit de l’innovation de processus.
- Il s’agit de l’innovation de produit.
- C’est la définition de l’innovation.
21.2 Systèmes d’innovation
Les activités innovantes ne sont pas réparties équitablement dans le monde, ni même au sein d’un pays. Pensez par exemple à la Silicon Valley en Californie, qui était à l’origine une région agricole paisible nichée dans la Santa Clara Valley. La Silicon Valley a obtenu son surnom quand des entreprises à forte croissance spécialisées dans l’informatique et la conception de semi-conducteurs s’y sont établies, plus tard rejointes par des innovateurs en biotechnologies. En 2010, dans une seule zone postale américaine (code ZIP 95054) au centre de la Silicon Valley, 20 000 brevets étaient enregistrés. Les avocats spécialistes des brevets se regroupent dans cette partie de Santa Clara. Si cette petite zone de 16,2 km2 était un pays, elle aurait été classée à la 17e place mondiale en matière de brevets en 2010.8
La multiplication des brevets dans la Silicon Valley est une illustration du volume de sa production qu’on appelle la connaissance codifiée, c’est-à-dire la connaissance qui peut être écrite. Cependant, la plupart des connaissances produites ne peuvent pas être écrites, ou du moins pas exactement. Ces connaissances non codifiables sont appelées connaissances tacites.
La différence entre connaissance codifiée et connaissance tacite peut être illustrée de la manière suivante : la recette pour un gâteau peut être écrite et donc constitue de la connaissance codifiée, mais être capable de lire la recette et de la suivre exactement ne vous donnera pas la réputation d’être un cuisinier extraordinaire. En revanche, la connaissance tacite d’un chef exceptionnel n’est pas quelque chose que vous pourrez facilement écrire dans un livre.
- connaissance codifiée
- Connaissance qui peut être écrite sous une forme qui permet sa compréhension par des tiers et est reproductible, comme la formule chimique d’un médicament. Voir également : connaissance tacite.
- connaissance tacite
- Connaissance faite de jugements, de savoir-faire et des autres compétences des individus participant au processus d’innovation. Ce type de connaissance ne peut pas être précisément écrit. Voir également : connaissance codifiée.
L’importance de la connaissance tacite est démontrée par la destruction et la ré-émergence de l’industrie chimique allemande. Après la Première Guerre mondiale, et de nouveau après la Seconde Guerre mondiale, les entreprises chimiques allemandes ont vu leurs usines en Allemagne détruites et leurs locaux aux États-Unis et en Grande-Bretagne expropriés. Il leur resta uniquement le personnel essentiel.
Si toute la connaissance nécessaire pour bâtir une industrie chimique moderne était codifiée, il n’y aurait pas eu de raison particulière pour que l’Allemagne retrouve sa position de leader de ce domaine. N’importe quel pays doté de nombreux scientifiques et ingénieurs auraient pu créer l’industrie en utilisant la connaissance codifiée disponible, un peu comme un cuisinier suivant une recette. En utilisant leur savoir-faire et leur expérience (leur connaissance tacite), les entreprises allemandes ont cependant réussi à retrouver des positions dominantes sur certains marchés.
La Silicon Valley est aussi bien reconnue pour sa connaissance tacite que pour sa connaissance codifiée brevetée. Cette concentration extraordinaire d’entreprises innovantes reflète l’importance des externalités et des biens publics dans la production et l’application de nouvelles technologies. Les deux mots « Silicon Valley » ne désignent plus seulement un endroit ; ils représentent maintenant une manière particulière de susciter l’innovation. La Silicon Valley est désormais associée à un système d’innovation.
Un système d’innovation inclut aussi bien les institutions légales qui protègent la connaissance codifiée et régissent la facilité avec laquelle les détenteurs de connaissance tacite se déplacent entre entreprises que les institutions financières, telles que les fonds de capital-risque, les banques et les entreprises technologiques, qui vont financer des projets visant à commercialiser des inventions.
Des pays différents offrent des systèmes d’innovation différents, qui évoluent souvent avec les domaines dans lesquels ces pays se spécialisent. Par exemple, l’innovation radicale est plus présente aux États-Unis, où les travailleurs peuvent facilement se déplacer entre les entreprises et où le capital-risque est très développé, tandis que l’innovation incrémentale est plus présente en Allemagne, où les liens des travailleurs avec leurs entreprises sont plus forts et où le financement de l’innovation se fait davantage via des profits non redistribués et les banques que via des fonds de capital-risque.
- clauses contractuelles de non-concurrence
- Un contrat de travail incluant une disposition ou un accord interdisant au salarié de quitter son entreprise pour rejoindre un concurrent. Cela peut réduire l’option de réserve du travailleur, diminuant le salaire que l’employeur a besoin de lui payer.
Même au sein des États-Unis, la Silicon Valley était une exception. Pendant les années 1960, la Silicon Valley n’était qu’un petit joueur de l’industrie technologique comparée à la concentration autour de la Route 128, près de Boston (Massachusetts), qui bénéficiait de la proximité de Harvard et du MIT. Mais la Route 128 différait de la Silicon Valley sur des points importants, comme l’usage des clauses de non-concurrence dans les contrats, qui interdisaient à quiconque quittant une entreprise d’être embauché dans une entreprise concurrente, afin de protéger l’innovation de l’entreprise :
- L’État du Massachusetts faisait appliquer des clauses de non-concurrence : cela a ainsi limité la mobilité inter-entreprises et le partage d’information qui aurait pu en découler.
- L’État de Californie a choisi de prendre la direction opposée : il a interdit les clauses de non-concurrence, en stipulant que « tout contrat selon lequel quiconque est empêché d’exercer un métier, une profession ou un commerce légal [était] […] nul ». La rotation des ingénieurs entre les entreprises de la Silicon Valley a ainsi soutenu la diffusion rapide des nouvelles connaissances entre ces entreprises.
Le système d’innovation de la Silicon Valley
Pourquoi l’innovation est-elle concentrée dans la Silicon Valley ? Les institutions et les incitations se renforcent mutuellement pour produire un cluster d’innovation radicale. Le modèle de la Silicon Valley est un modèle d’entrepreneurs, d’investisseurs et d’employés très mobiles reliés au sein d’une petite aire géographique et soutenus par les institutions éducatives et par l’État.9 10
Le système de la Silicon Valley est caractérisé par :
- Des entreprises innovantes : la plupart des innovations apparaissent dans des entreprises spécialisées dans la production de nouvelles méthodes ou produits (jeunes entreprises innovantes ou start-ups), plutôt que dans des entreprises existantes produisant des biens et des services.
- D’autres institutions innovantes : dans le cadre d’un partenariat noué au début du 20e siècle, deux universités, l’une publique (université de Californie à Berkeley), l’autre privée (université Stanford), travaillent en lien étroit avec des entreprises pour commercialiser des innovations. Un parc industriel a été établi en 1951 à Stanford avec des entreprises majeures telles que General Electric, IBM et Hewlett Packard. Des laboratoires de R&D publics, privés ou universitaires sont situés dans la Vallée, comme le centre de R&D de Walmart, le géant des supermarchés.
- L’État : la recherche militaire en électronique et en physique des hautes énergies, commençant lors de la préparation à la Seconde Guerre mondiale, était financée par les universités et les entreprises privées de la région. Pendant la Guerre Froide (de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu’aux années 1990), cela a continué avec Lockheed Missiles and Space, le plus gros employeur de la Vallée. Un changement législatif en 1980, le Bayh-Dole Act, a permis aux universités de devenir propriétaires de leurs résultats et de les commercialiser, même en cas d’aide financière accordée par le gouvernement fédéral. Cela attira des investisseurs privés dans le réseau.
- Des normes sociales : une norme sociale favorisant les comportements à risque élevé et fort rendement – qui, pour certains, trouve son origine dans le déferlement au 19e siècle en Californie de spéculateurs en quête d’or – soutient une culture d’entrepreneuriat en série. Les innovateurs qui échouent peuvent recommencer avec une nouvelle idée. Des taux de faillite élevés et d’autres facteurs favorisant une mobilité des employés inter-entreprise permettent de diffuser la connaissance tacite acquise dans une entreprise entre les autres entreprises. Certains en ont conclu que le partage fortuit de l’information entre les entreprises était la clé du succès de la Silicon Valley.
- Finance : les entrepreneurs présentent leur projet à des investisseurs en capital-risque à un stade assez précoce. Quand ceux-ci décident d’investir et de prendre une participation substantielle dans le capital de l’entreprise, généralement pour une période de douze à dix-huit mois, cela crée une incitation forte pour la start-up à croître rapidement et, en cas de succès, cela signifie que l’investisseur en capital-risque peut se retirer avec un taux de profit élevé. Le modèle de création d’une start-up est un cycle rapide de présentation d’une idée d’entreprise fondée sur la commercialisation d’une invention à des investisseurs, suivie par le recrutement d’employés clés (souvent avec des rémunérations indexées sur la valeur de l’entreprise une fois vendue), la croissance du marché et la recherche de nouveaux financements. Les fondateurs, investisseurs et employés ont tous conscience que l’échec est probable. Les investisseurs réalisent néanmoins des bénéfices. Les rares investissements à succès produisent des rendements importants qui compensent les nombreuses pertes.
Le système d’innovation allemand
L’innovation aux États-Unis est concentrée dans les industries dont les brevets se réfèrent massivement à des articles scientifiques. C’est un indicateur d’innovation radicale. Au contraire, les industries allemandes ayant une forte réussite à l’exportation reposent sur une innovation incrémentale, où les brevets citent beaucoup moins d’articles scientifiques et où la connaissance tacite tend à être plus importante. Les réseaux sont également cruciaux pour le système d’innovation allemand, mais ils fonctionnent différemment de ceux qui sont à l’œuvre dans la Silicon Valley. Comme la Silicon Valley, l’innovation est concentrée géographiquement, avec des centres autour de Munich et Stuttgart en Allemagne du sud-ouest.
Le système allemand est caractérisé par :
Lisez l’introduction de : Peter A. Hall and David Soskice. 2001. Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage. New York, NY: Oxford University Press.
- Des entreprises innovantes : l’innovation incrémentale apparaît dans les grandes et moyennes entreprises à longue durée de vie en Allemagne et repose sur des relations de long terme entre employeurs et travailleurs, entre entreprises et banques et entre entreprises liées à la fois par des relations de production et par des liens de contrôle et de propriété. Pour réussir à introduire une nouvelle technologie, les entreprises font face à de nombreux problèmes de coordination, que des relations de coopération aussi bien que de concurrence avec les employés, les autres entreprises et les banques aident souvent à résoudre.
- Un État : l’État soutient la formation de travailleurs très qualifiés à travers un système d’apprentissage, supervisé par les branches industrielles. Ce système réduit les coûts de formation pour les entreprises et garantit une formation de haute qualité. Les apprentis y contribuent en acceptant de faibles salaires pendant leur formation. Les grandes entreprises sont obligées d’avoir des conseils élus pour représenter les travailleurs dans les négociations avec les dirigeants. Ils aident à trouver les moyens d’exploiter tous les gains mutuels et de distribuer ces gains d’une manière acceptable pour tous.
- Des innovateurs : des travailleurs qualifiés sont nécessaires pour l’introduction réussie d’innovations de procédé et de produit. Pour rendre cela possible, les jeunes gens doivent être assurés d’un emploi de longue durée à salaire élevé avant de vouloir s’engager dans des apprentissages de plusieurs années. De même, les travailleurs qui produisent des innovations qui pourraient aboutir à des suppressions d’emploi doivent être assurés qu’ils ne vont pas perdre leur emploi en conséquence. Le système d’apprentissage résout ces problèmes de bien des manières. Comme cela a été mentionné précédemment, l’État soutient et subventionne des apprentissages de haute qualité. Ces formations sont également certifiées. Cela assure aux apprentis que leurs compétences ont de la valeur hors de leur entreprise, améliorant alors leur position de réserve en cas de perte d’emploi et aidant à garantir des salaires élevés tant que l’emploi est conservé.
- Des normes sociales : l’innovation incrémentale (par exemple, dans l’industrie automobile) requiert des standards communs à un secteur afin de rendre les transferts de technologie plus faciles. Les relations de long terme et l’existence de participations croisées entre entreprises sont essentielles pour faciliter les transferts de technologie, parce que les contrats de travail longs rendent bien moins communs les transferts de technologie qui ont lieu quand les travailleurs passent d’une entreprise à l’autre, comme dans la Silicon Valley. De même, la garantie que les travailleurs bien formés d’une entreprise ne seront pas recrutés agressivement par les autres entreprises n’est pas légale, mais maintenue par des normes qui sont largement respectées par des entreprises qui par ailleurs sont en forte concurrence entre elles.
- Finance : le système de propriété des grandes entreprises allemandes est très différent de celui en place aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Les rachats sont plus faciles aux États-Unis ou au Royaume-Uni et permettent de rapides changements dans l’utilisation des actifs d’une entreprise. C’est parce que la propriété des entreprises est beaucoup plus concentrée en Allemagne qu’il est virtuellement impossible qu’un rachat hostile (c’est-à-dire auquel s’opposerait la direction) se produise. Ainsi, cela permet de construire des collaborations technologiques de long terme entre entreprises et de définir plus facilement des normes sectorielles. Le financement de l’innovation en Allemagne provient de l’autofinancement (profits non distribués aux actionnaires) et des prêts bancaires. Le financement de long terme donne une assurance aux apprentis qui investissent dans l’acquisition de compétences spécifiques à l’entreprise, ainsi qu’aux autres entreprises qui investissent dans des développements technologiques connexes.
La Figure 21.5 compare les deux systèmes. Tous deux ont du succès, mais de manière différente. Les entreprises de la Silicon Valley dominent les technologies numériques (TIC) importantes associées aux technologies à usage général les plus récentes, alors que les entreprises allemandes qui forment leur système d’innovation particulier ont réussi à maintenir bien plus d’emplois bien payés dans l’industrie, en dépit de la concurrence, par rapport aux États-Unis ou à n’importe quel pays en dehors d’Asie orientale.
| Silicon Valley | Système d’innovation allemand | |
|---|---|---|
| Innovation | Rarement codifiée, notamment dans les TIC | Tacite et incrémentale, notamment dans les biens d’équipement et les équipements de transports |
| Entreprises innovantes | Spécialistes de l’innovation entrepreneuriale | Entreprises industrielles ou autres, solidement établies |
| Interventions publiques | Contrats militaires, enseignement supérieur | Subventions à la formation des travailleurs |
| Innovateurs | Ingénieurs, scientifiques, universités | Travailleurs qualifiés et ingénieurs |
| Normes sociales | Concurrence, prise de risque | Coopération, partage de risque |
| Système financier | Capital-risque | Prêts bancaires, autofinancement |
| Droits de propriété | Importance considérable des brevets | Les formes de protection autres que les brevets sont plus importantes |
Figure 21.5 Deux systèmes d’innovation : Silicon Valley et Allemagne.
Économie des systèmes d’innovation
Une innovation efficace peut contribuer à augmenter les niveaux de vie, en augmentant l’ensemble des produits disponibles pour les consommateurs et en réduisant le prix de produits existants. Cependant, de nombreux pays connaissent des difficultés à innover. L’économiste Lisa Cook, de l’Université d’État du Michigan, se demande pourquoi la transition vers le capitalisme en Russie dans les années 1990 n’a pas déclenché une vague d’innovation. Elle documente les inventions de la fin du 19e siècle apportées par des inventeurs afro-américains, notamment des masques à gaz, des feux de circulation et de la technologie des ampoules électriques. Elle explique comment cette vague d’innovations a été interrompue par une vague d’attaques et de violence collective anti-Noirs. Ses observations des conditions politiques et économiques dans lesquelles l’innovation peut prospérer sont pertinentes pour comprendre les grandes différences qui existent aujourd’hui à travers le monde quant au degré d’innovation.
Comparez le niveau d’innovation dans les économies capitalistes au niveau d’innovation dans les économies planifiées de l’Union soviétique et de ses alliés pendant le 20e siècle. Dans une liste de 111 innovations majeures en matière de produits et de procédés non militaires entre 1917 et 1998, une seule – le caoutchouc synthétique – provient des pays du bloc soviétique. Les chercheurs ont suggéré qu’un facteur important ayant contribué à l’effondrement des économies planifiées soviétiques fut l’érosion de la légitimité du pouvoir du parti communiste due à son échec en matière d’innovation concernant les biens de consommation.11
Les systèmes d’innovation capitalistes à succès de la Silicon Valley et de l’Allemagne ont deux choses en commun :
- Le système d’innovation n’est pas fondé sur la créativité individuelle : une seule entreprise ou un seul inventeur dépend des relations entre tous les acteurs – propriétaires, employés, gouvernements et sources de financement. Les régions ne disposant pas de ces réseaux de soutien réussissent moins à innover ;
- Il y a tout à la fois une main qui guide et une « main invisible » : les systèmes d’innovation à succès supposent une recherche concurrentielle du profit entre individus et entreprises, mais l’État joue aussi un rôle essentiel – les contrats militaires dans la Silicon Valley ou la formation des travailleurs en Allemagne, par exemple.
Dans les trois prochaines sections, nous allons explorer les trois aspects de l’invention et de la diffusion qui font de l’innovation un défi pour les politiques publiques. Nous verrons aussi pourquoi il a été si difficile pour certaines régions de reproduire les systèmes d’innovation de la Silicon Valley ou de l’Allemagne.
- effet externe
- Un effet positif ou négatif d’une production, consommation ou d’une autre décision économique sur un autre individu ou plusieurs, qui n’est pas spécifié comme actif ou passif dans un contrat. L’effet est dit externe car l’effet en question est extérieur au contrat. Connu également sous le terme : externalité. Voir également : contrat incomplet, défaillance du marché, bénéfice externe, coût externe.
- bien public
- Un bien dont l’usage par un individu ne limite pas sa disponibilité pour les autres. Connu également sous le terme : bien non rival. Voir également : bien public non exclusif, bien artificiellement rare.
- économies d’échelle
- C’est le cas lorsque doubler tous les facteurs de production fait plus que doubler le niveau de la production. La forme de la courbe de coût moyen à long terme de l’entreprise dépend non seulement des rendements d’échelle dans la production mais également de l’effet d’échelle sur les prix que l’entreprise paye pour ses facteurs de production. Connu également sous le terme : rendements d’échelle croissants. Voir également : déséconomies d’échelle.
Ces aspects sont :
- Les externalités et le problème de coordination entre innovateurs : l’invention réussie d’une entreprise a presque toujours des effets soit positifs, soit négatifs sur la valeur des investissements des autres entreprises dans le processus d’innovation. Les propriétaires d’une entreprise qui sont uniquement préoccupés par leurs profits ne vont pas réussir à prendre en compte ces externalités.
- Les biens publics : l’innovation peut être vue comme la production de connaissances nouvelles par l’usage d’une combinaison de connaissances anciennes et de créativité. Le fait que la plupart des formes de connaissances soient non rivales – les rendre disponibles à un utilisateur supplémentaire ne signifie pas qu’un utilisateur actuel en sera dépossédé – fait du processus d’innovation un processus qui utilise des biens publics pour produire d’autres biens publics.
- Les économies d’échelle et une concurrence où le gagnant remporte tout : ce qui est efficace doit être grand, quand il s’agit d’une économie fondée sur la connaissance. Les coûts moyens diminuent lorsque la quantité de biens ou de services fournis augmente et cela signifie que les entreprises qui entrent les premières sur un marché peuvent souvent conquérir l’ensemble de ce marché, du moins temporairement.
Rappelez-vous que d’après l’Unité 12, ces trois caractéristiques sont toutes sources de défaillances de marché. Laisser simplement la concurrence sur le marché réguler le processus d’innovation ne va en général pas aboutir à un résultat efficace. Ces trois aspects du processus d’innovation représentent ainsi un défi pour les États qui tentent de faire face à ces défaillances de marché. En effet, les pouvoirs publics manquent généralement des informations (ou de la motivation) nécessaires pour développer des politiques publiques appropriées.
Dans ce qui suit, nous commençons avec un modèle permettant d’étudier le problème des externalités et de la coordination entre les innovateurs, et réduit à seulement deux entreprises envisageant d’investir ou non dans des innovations et un gouvernement pouvant intervenir pour aider le processus d’innovation.
Exercice 21.3 Comparaison des systèmes d’innovation
Dans cette unité, nous avons comparé les systèmes d’innovation de la Silicon Valley et de l’Allemagne.
Lequel de ces deux systèmes vous paraît le plus à même d’être introduit et de réussir dans le pays ou la région que vous habitez ? Pourquoi ? (Si vous êtes en Allemagne, le système de la Silicon Valley fonctionnerait-il chez vous ? Si vous êtes en Californie, le système allemand fonctionnerait-il chez vous ?)
Question 21.2 Choisissez la ou les bonnes réponses
Laquelle de ces affirmations concernant les systèmes d’innovation de la Silicon Valley et de l’Allemagne est correcte ?
- Les deux systèmes, bien que très différents, sont tous les deux considérés comme des réussites. Les entreprises de la Silicon Valley dominent les technologies essentielles de l’information et de la communication, tandis que les entreprises allemandes ont réussi à maintenir un niveau bien plus élevé d’emplois industriels bien rémunérés malgré la concurrence mondiale.
- Bien que cette affirmation soit vraie pour la Silicon Valley, les travailleurs en Allemagne sont formés par des années en apprentissage, avec de faibles salaires.
- Comme c’est expliqué dans le texte.
- Le financement de l’innovation en Allemagne vient de l’autofinancement et de prêts bancaires, qui permettent d’investir dans des compétences plus spécifiques à chaque industrie.
21.3 Externalités : compléments, substituts et coordination
- compléments
- Deux biens pour lesquels la hausse du prix de l’un cause une réduction de la quantité demandée de l’autre. Voir également : substituts.
- substituts
- Deux biens pour lesquels la hausse du prix de l’un cause une augmentation de la quantité demandée de l’autre. Voir également : compléments.
Les innovations envisagées par une entreprise vont généralement soit augmenter, soit diminuer le niveau de profit des autres entreprises et affecter leurs choix en termes d’innovation. Pensez simplement à deux entreprises, chacune envisageant des innovations qui sont :
- Complémentaires : la valeur d’une innovation dépend de la présence d’une autre innovation. Les boîtes de conserve furent inventées pour stocker de la nourriture en 1810 par Peter Durand, un marchand britannique et la première usine fabriquant les boîtes de conserve commença la production en 1813. Cependant, les boîtes étaient très difficiles à ouvrir et ne furent pas largement utilisées avant 1858, quand Ezra Warner inventa un ouvre-boîte simple à utiliser.
- Substituables : les deux innovations prises séparément ont une valeur, mais qui diminue quand l’autre innovation a déjà eu lieu. Un bon exemple est celui de la guerre des formats vidéo, pendant les années 1980, entre deux standards concurrents : VHS et Betamax. Les vidéos réalisées avec l’un ne pouvaient pas être lues avec un lecteur fait pour lire l’autre. Betamax de Sony ou VHS de JVC aurait constitué un bon format pour stocker des vidéos sur cassette, mais le lancement simultané des deux technologies a mené à une rivalité coûteuse.
En l’absence de politiques publiques explicites ou de moyens de coordination privés entre les entreprises, les défis posés par des innovations complémentaires ou substituables sont assez différents :
- Quand les innovations potentielles sont complémentaires : elles ne sont pas toujours réalisées malgré un bénéfice social et des profits pour les entreprises si les deux avaient été introduites.
- Quand les innovations potentielles sont substituables : parfois, les deux innovations apparaissent en même temps, alors qu’une seule innovation aurait été plus profitable socialement et économiquement à toutes les entreprises impliquées. La concurrence entre des substituts peut imposer un coût élevé aux deux innovateurs.
Nous pouvons utiliser la théorie des jeux pour comprendre comment deux entreprises potentiellement innovantes interagissent stratégiquement et montrer pourquoi ces différents problèmes surviennent et pourquoi ils peuvent être difficiles à résoudre (il serait peut-être préférable que vous revoyiez l’introduction à la théorie des jeux de l’Unité 4).
Innovations complémentaires
Imaginez deux entreprises hypothétiques : Plugcar, qui hésite à développer une nouvelle voiture électrique, et Netflex, qui compare les coûts et les bénéfices estimés suite à un investissement dans un réseau mobile d’échanges de batteries. Comme précédemment, la présence de Netflex donne plus de valeur à la décision de Plugcar, et vice versa, de telle sorte qu’elles sont complémentaires. Elles vont prendre leurs décisions (innover ou ne pas innover) indépendamment, mais connaissent les pertes et gains qui vont résulter de chacun des quatre résultats possibles. Ceux-ci sont indiqués dans la matrice des gains ci-dessous. Le joueur en ligne est Plugcar et ses gains sont indiqués en premier dans chaque cellule ; le joueur en colonne est Netflex et ses gains sont indiqués en dernier dans chaque cellule. Les nombres positifs sont des profits pour l’entreprise, les nombres négatifs, des pertes.
Imaginez que vous êtes Plugcar. Si vous n’innovez pas, vous obtenez zéro, indépendamment de ce que joue Netflex. Si vous savez que Netflex ne va pas introduire son produit, vous n’allez sûrement pas développer la Plugcar. Qu’en est-il si Netflex introduit son produit ? Si vous innovez, vous gagnez 1 en profit. Mais vous courrez aussi le risque d’avoir des pertes de 0,5 si Netflex n’innove pas.
À moins d’être vraiment certain(e) que Netflex va innover, vous pouvez décider qu’il y a de meilleures manières d’utiliser vos fonds. Si Netflex raisonne de la même manière, alors aucune entreprise ne va innover, tandis que si elles l’avaient fait, chacune en aurait profité.
Innovations substituables
Quand deux innovations sont substituables, nous avons le problème opposé. Un bon exemple est la guerre des formats vidéo pendant les années 1980 entre deux standards concurrents, le format VHS (pour « Video home system », système vidéo domestique, développé par Victor Company of Japan (JVC)) et le format Betamax de Sony. Comme indiqué plus haut, les supports vidéo utilisant un format ne pouvaient pas être lus sur des appareils prévus pour lire l’autre, de telle sorte que chaque entreprise avait un intérêt à ce que son format soit utilisé le plus largement possible.
Nous considérons à présent deux entreprises hypothétiques, inspirées par le cas Sony-JVC. La matrice des gains à laquelle elles font face est donnée par la Figure 21.7. JVC est le joueur en ligne et Sony le joueur en colonne. Comme auparavant, la première entrée dans chaque cellule est le gain pour le joueur en ligne.
Si Sony était sûr que JVC innove, alors il risquerait une bataille coûteuse avec des pertes importantes en cas de victoire de JVC. Les gains dans la cellule supérieure gauche sont négatifs pour les deux entreprises, car les coûts de développement du nouveau produit et de la concurrence pour l’obtention des parts de marché ne sont pas compensés par la perspective incertaine des profits en cas de victoire. Évidemment, si Sony savait que JVC ne comptait pas investir, ou si Sony était sûr de gagner une bataille assez peu coûteuse grâce à son produit si tous les deux devaient investir, alors Sony devrait de façon très claire investir. Il serait le vainqueur qui rafle la mise en obtenant tous les profits, tout en infligeant des pertes à JVC.
Le résultat est qu’il y a parfois trop peu d’innovation pour le bien de la société quand les idées sont complémentaires et trop quand les innovations sont substituables.
Rôle des politiques publiques
Compléments
Si les gains de la matrice étaient connus de tous, alors un État avisé saurait que la case en haut à gauche (Innover, Innover) de la Figure 21.6 est le meilleur résultat pour la société. Il pourrait, dans le cas d’innovations complémentaires, accorder des subventions suffisantes pour que les deux entreprises préfèrent investir même si l’autre ne le fait pas. Ou, de manière plus raisonnable, il pourrait aider les deux entreprises à coopérer dans le processus d’innovation, en promettant de ne pas les attaquer au motif de pratiques anti-concurrentielles si la prise de décision coordonnée est interdite par la législation anti-collusion ou d’autres lois.
En réalité, mettre en place des politiques publiques permettant d’éviter un résultat défavorable est un défi bien plus important que ce que notre modèle simplifié peut suggérer. Il y aura probablement plus de deux innovateurs potentiels, avec de nombreux modèles proposés pour les voitures électriques et pour les systèmes de recharge. L’État devrait choisir quelles entreprises doivent coopérer, et les conditions dans lesquelles cette coopération aurait lieu. Dans ce cas, les entreprises auraient une incitation à dépenser des ressources pour influencer les décisions publiques (lobbying). Comme nous le verrons dans l’Unité 22, il y a de nombreuses raisons expliquant pourquoi les pouvoirs publics peuvent échouer à mettre en place un résultat socialement bénéfique dans des cas comme celui-là.
Les échanges privés peuvent avoir un rôle à jouer ici. Si les entreprises elles-mêmes ont de meilleures informations que l’État, elles peuvent mettre en place des accords privés. Il s’agit ici de l’équivalent de la négociation entre des entités économiques privées qui avait lieu dans l’Unité 12 pour offrir une alternative à la réglementation sur les désherbants chimiques.
Enfin, des entreprises avec des innovations potentiellement complémentaires peuvent accepter de fusionner afin que le problème de coordination des décisions d’innovation devienne interne à une seule entreprise.
Substituts et standards
Les substituts de la Figure 21.7 présentent des défis similaires aux politiques publiques. Il peut y avoir un grand nombre d’innovations substituables en concurrence. Le Betamax de Sony et la VHS de JVC n’étaient pas les seuls entrants dans les phases initiales de la guerre des formats. Les gouvernements peuvent manquer d’informations essentielles et peuvent être influencés par l’une des entreprises concurrentes.
Parfois, comme nous le verrons plus tard, la technologie de l’un des concurrents l’emporte sur l’autre : par exemple, Betamax finit par disparaître et VHS devint le standard universel pour les cassettes vidéo individuelles. Parfois, les entreprises d’une industrie appliquent les mêmes standards, car leur cohérence augmente la taille du marché et toutes en bénéficient. Un exemple est la manière dont l’industrie du transport a mis en place un standard pour la taille des containers transportés, qui permit aux camions et aux ports de devenir plus efficaces, et de réaliser ainsi des économies d’échelle.
Souvent cependant, les organismes du secteur public jouent un rôle important pour faciliter l’obtention d’accords entre l’ensemble des entreprises d’un secteur concernant les standards techniques. Il s’agit en général d’organes internationaux, tels que l’Union Internationale des Télécommunications ou la Commission européenne. L’Union européenne, par exemple, a aidé les entreprises de téléphonie mobile à s’accorder sur le standard GSM pour les combinés téléphoniques et les réseaux, permettant à tous les fabricants et opérateurs de bénéficier d’un réseau européen de téléphonie mobile à forte croissance et aux consommateurs de bénéficier de la possibilité d’appeler des personnes ayant souscrit un abonnement auprès d’autres opérateurs et de prix en baisse.
Exercice 21.4 Compléments
- Faites la liste de quelques paires d’innovations qui sont complémentaires, et d’autres qui sont substituables.
- Dans le jeu de la Figure 21.6, avec quelle probabilité chaque entreprise devrait-elle savoir que l’autre entreprise choisira Innover, afin qu’Innover soit profitable pour elle-même ? Expliquez votre réponse. (Indice : comparez les gains espérés de choisir l’une ou l’autre des options, étant donné la probabilité x que l’autre entreprise choisisse Innover. Quelle fourchette de probabilités donnerait un gain espéré supérieur en choisissant Innover ?)
Exercice 21.5 Substituts et compléments
- Retournez à la Figure 4.16a et observez le jeu entre Bettina et Astrid, dans lequel elles choisissaient quel langage de programmation utiliser, C++ ou Java. Décrivez les similarités et les différences dans les stratégies, les gains et le résultat optimal de la Figure 4.16 par rapport au jeu Sony-JVC décrit ici.
- Dans la Figure 21.7, pour que l’innovation soit profitable, avec quelle probabilité l’autre entreprise devrait-elle choisir Ne pas innover ?
Faites maintenant l’hypothèse que les décisions dans les Figures 21.6 et 21.7 sont prises de façon séquentielle et non plus simultanément. Dans le cas de substituts (Sony et JVC), imaginez que JVC ait développé son produit et l’ait mis sur le marché (ou ait au moins convaincu Sony qu’il le ferait). Dans le cas de compléments (Plugcar et Netflex), faites l’hypothèse que Plugcar puisse convaincre Netflex qu’il va dans tous les cas mettre la nouvelle voiture électrique sur le marché.
- Expliquez quel serait le résultat dans les deux situations, si les deux entreprises prennent leurs décisions de façon séquentielle et non plus simultanément.
Question 21.3 Choisissez la ou les bonnes réponses
La matrice suivante présente les gains pour deux entreprises, selon qu’elles innovent ou pas. Le premier nombre est le gain pour l’entreprise A et le second, celui de l’entreprise B.
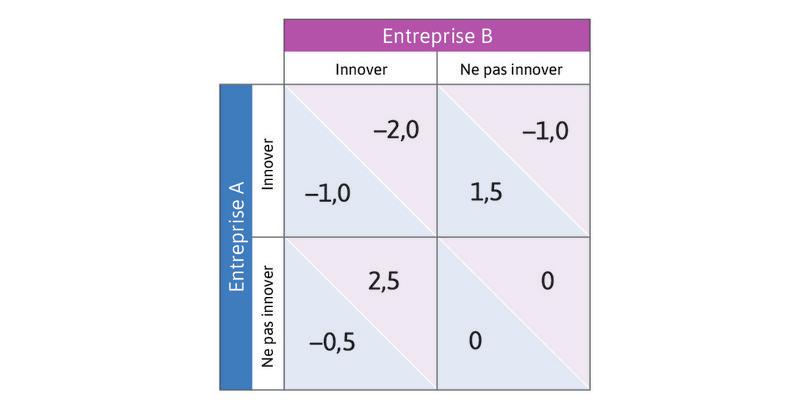
D’après ces informations, laquelle de ces affirmations est correcte ?
- Le gain de l’innovation de l’un est diminué par l’innovation de l’autre. Dès lors, les deux sont substituables.
- Les deux équilibres de Nash de ce jeu sont (Innover, Ne pas innover) et (Ne pas innover, Innover).
- L’entreprise B subira de fortes pertes si l’entreprise A innove également. Il n’est donc pas certain que l’entreprise B innovera également.
- Si la probabilité que l’entreprise B choisisse Innover est de x %, alors l’entreprise A reçoit –x + 1,5(1 – x) en choisissant Innover contre –0,5x en choisissant Ne pas innover. L’entreprise A préfère Innover si –x + 1,5(1 – x) > –0,5x, ce qui est vrai si x < 0,75.
21.4 Économies d’échelle et concurrence où le vainqueur remporte la mise
Innover implique le développement de nouvelles connaissances et leur mise en pratique. Souvenez-vous que la connaissance est particulière à deux titres. C’est un bien public (ce que l’un consomme ne diminue pas ce qui est disponible pour les autres) et sa production et son usage sont caractérisés par d’extraordinaires rendements d’échelle croissants. Nous avons parlé de la connaissance comme un bien public dans l’Unité 12. Dans cette section, nous allons traiter les deux manières, pour une innovation intensive en connaissance, de créer des économies d’échelle.
Du côté de l’offre : coûts du premier exemplaire et économies d’échelle dans la production
- coûts du premier exemplaire
- Les coûts fixes de la production d’un bien ou d’un service intensif en connaissances.
Le premier exemplaire d’une nouvelle connaissance est coûteux à produire, mais il ne coûte quasiment rien de le rendre disponible aux autres. Comme les coûts du premier exemplaire sont importants relativement aux coûts (variables ou marginaux) pour disposer de biens supplémentaires, la production et la distribution d’information sont différentes de toutes les autres parties de l’économie.
- Thriller, de Michael Jackson : c’est l’album le plus vendu de l’histoire. Il a coûté 750 000 $ à produire en 1982 (à peu près deux fois ce montant en dollars de 2015). Le coût marginal de production des copies supplémentaires était inférieur à 1 $ pour un CD et quasiment nul pour un téléchargement. Un CD se vend 10 $ environ et un téléchargement légal approximativement le même montant. Le coût de premier exemplaire d’une production modeste par un nouveau groupe sera d’au moins 10 000 $, avec un coût marginal d’environ 1 $ pour chaque CD et de 0 pour un téléchargement.
- Manuels : développer un nouveau manuel scolaire de bonne qualité aux États-Unis coûte entre 1 et 2 millions de dollars pour rémunérer les auteurs, les graphistes, les éditeurs et les autres personnes impliquées. C’est le coût de premier exemplaire. Le coût de production et de distribution des exemplaires physiques du manuel (imprimerie, stockage et distribution inclus) pour un texte réussi est d’environ 12 $ par livre. C’est le coût marginal. Les étudiants du monde entier savent que les manuels introductifs se vendent généralement pour dix fois ce montant.
- Star Wars : Le Réveil de la Force : le budget de production du film sorti en 2015 était de 200 millions de dollars. Le coût de développement pour le jeu informatique Star Wars : The Old Republic (2011) était compris entre 150 et 200 millions de dollars. Ces chiffres ne prennent pas en compte les coûts de marketing et de promotion, tels que la publicité, qui doivent être inclus dans le coût de premier exemplaire et peuvent être plus importants que les coûts de production eux-mêmes. Maintenant que les films sont distribués numériquement aux cinémas, rendre un film disponible ne coûte quasiment rien. Le coût marginal pour des films ou des jeux vendus sur DVD est environ le même que pour un CD et quand ils sont vendus en ligne, il est égal à zéro.
- Nouveaux médicaments : le coût moyen de premier exemplaire pour un nouveau médicament, d’après une étude de 2003 portant sur les États-Unis, était de 403 millions de dollars. Cela explique la différence de prix entre les médicaments qui sont encore sous brevet, donnant au producteur un monopole temporaire, et le prix que les utilisateurs paient une fois que le brevet a expiré, de sorte que d’autres producteurs peuvent être en concurrence avec le laboratoire à l’origine du médicament. Par exemple, l’Omeprazole, un médicament contre l’indigestion largement prescrit, a été breveté et lancé en 1989 sous la marque Prilosec. Aux États-Unis, le brevet expira en 2001 et en 2003, 28 cachets de la marque Prilosec coûtaient 124 $, tandis que le paquet équivalent d’Omeprazole générique coûtait seulement 24 $.12
Dans l’Unité 7, nous avons étudié la manière dont une entreprise fixe les prix, et dont elle décide de la quantité à produire. Sur la Figure 21.8, nous montrons un ensemble de courbes de coût pour une entreprise produisant un bien intensif en connaissances. Les valeurs sont hypothétiques et sous-estiment l’ampleur réelle du coût du premier exemplaire par rapport au coût marginal. Même ainsi, l’axe des ordonnées n’est pas dessiné à l’échelle afin de pouvoir lire le graphique.
- Coût total : la courbe débute avec le coût du premier exemplaire, et augmente ensuite très peu avec la production.
- Coût marginal (Cm) : la courbe est basse et constante.
- Coût moyen (CM) : la courbe (incluant les profits économiques et les coûts de premier exemplaire) décroît à mesure que la quantité augmente, lorsque le coût de premier exemplaire est réparti sur de plus larges volumes de production.
- Cm < CM : quel que soit le nombre d’unités produites, le coût marginal est toujours plus faible que le coût moyen.
Une entreprise produisant un bien intensif en connaissances et qui désire réaliser des profits économiques va devoir couvrir son coût de premier exemplaire. Pour ce faire, le prix doit être au moins aussi élevé que la courbe de coût moyen, et donc être supérieur au coût marginal.
Cela signifie que la production de biens intensifs en connaissances ne peut pas être décrite par un modèle de marchés concurrentiels, comme dans l’Unité 8, où le prix est égal au coût marginal (P = Cm), mais plutôt par le modèle d’entreprises fixant leurs prix vu dans l’Unité 7. Dans l’Unité 7, nous avons fait l’hypothèse que P > Cm en raison d’une concurrence limitée. Ici, il s’agit d’une conséquence inévitable des coûts du premier exemplaire et quel que soit le nombre de concurrents, le prix ne peut pas être réduit par la concurrence jusqu’à devenir égal au coût marginal.
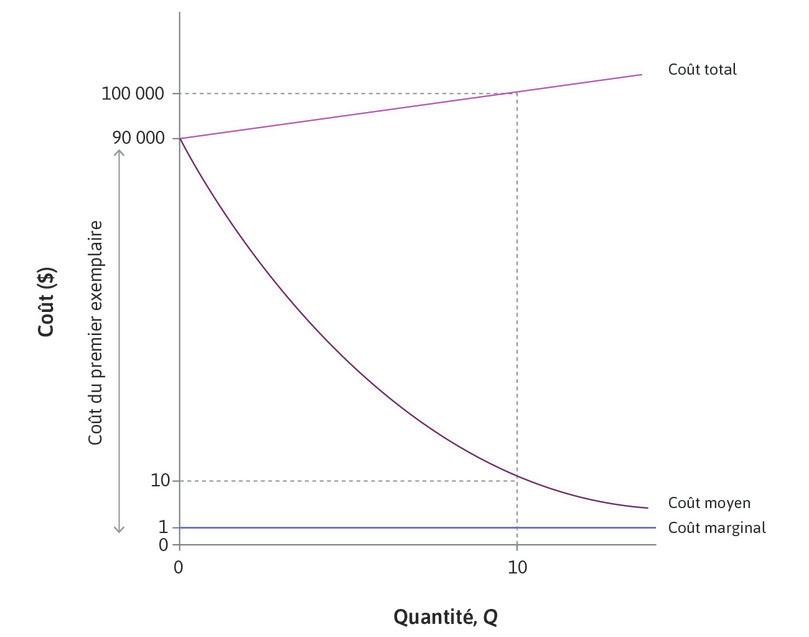
Figure 21.8 Un bien intensif en connaissances : coût marginal, coût moyen et coûts du premier exemplaire.
Plus tôt dans cette unité (et dans les Unités 1 et 2), nous avons expliqué qu’en l’absence de droits de propriété, la concurrence d’imitateurs éliminerait au bout d’un moment les rentes d’innovation des premiers à avoir adopté une nouvelle technologie ou un nouveau produit. C’est ainsi que la diffusion d’une nouvelle technologie a lieu et cela aboutit à des prix plus faibles. Le même processus aura également lieu si les coûts de la première copie sont importants. D’autres entreprises vont copier l’innovateur jusqu’à ce que les profits économiques (rentes) soient éliminés, de sorte que le prix appliqué compense le coût moyen de production, y compris le coût de la première copie et le coût d’opportunité du capital utilisé. Mais dans cette situation, le prix appliqué doit être plus important que le coût moyen (du fait des coûts du premier exemplaire, comme cela est montré sur la Figure 21.8). La Figure 21.9 illustre ces cas.
| Entrée limitée (droits de propriété intellectuelle ou autres) | Entrée libre | |
|---|---|---|
| Coûts moyens décroissants | Profits économiques P > CM > Cm |
Pas de profits économiques P = CM > Cm |
| Coûts moyens non décroissants | Profits économiques P > Cm ⋛ CM |
Pas de profits économiques P = Cm = CM |
Figure 21.9 Courbe de coût moyen, profits économiques et concurrence.
Du côté de la demande : économies d’échelle à travers des effets de réseau
- effet externe des réseaux
- Un effet externe d’une action d’une personne sur une autre, qui se produit car les deux sont connectées via un réseau. Voir également : effet externe.
La valeur de la plupart des formes de connaissance augmente lorsqu’un plus grand nombre de personnes les utilisent. Puisque les avantages pour les utilisateurs augmentent quand la taille du réseau d’utilisateurs augmente, des rendements croissants du côté de la demande sont parfois appelés externalités de réseau. Cette externalité vient du fait que, quand une nouvelle personne rejoint le réseau, les autres membres en bénéficient.
Les langues sont un bon exemple. Aujourd’hui, plus d’un milliard d’individus apprennent l’anglais, plus de trois fois plus que le nombre de personnes dont l’anglais est la langue maternelle. La demande pour l’anglais ne provient pas d’une supériorité intrinsèque de la langue ou de sa simplicité d’apprentissage (comme beaucoup d’entre vous l’auront remarqué), mais simplement du fait que de nombreuses autres personnes, dans de nombreuses parties du monde, le parlent. Il y a beaucoup plus de personnes dont la langue maternelle est le mandarin (chinois) ou l’espagnol et presque autant pour l’hindi et l’arabe, mais aucune de ces langues n’est aussi utile pour communiquer dans le monde que l’anglais.
Avoir une console de jeux vidéo particulière est mieux quand de nombreuses personnes ont la même, car les développeurs vont produire plus de jeux pour cette console. Une carte de crédit est également plus utile quand de nombreux individus ont la même, car de nombreux magasins vont l’accepter comme moyen de paiement.
Mais vous êtes-vous déjà demandé qui avait acheté le premier téléphone et ce qu’il avait l’intention de faire avec ? Ou encore, ce que l’on pouvait faire avec le premier fax ?
La technologie derrière le fax, un appareil pour envoyer des images de documents via une ligne téléphonique, a été brevetée pour la première fois par Alexander Bain en 1843 – même si son innovation permettant l’envoi d’images utilisait alors le télégraphe, car personne n’avait encore inventé le téléphone. Un service commercial qui pouvait transmettre des signatures écrites à la main en utilisant le télégraphe fut disponible dans les années 1860. Cependant, le fax demeura un produit de niche jusqu’à ce que, cent vingt ans plus tard, il devienne si populaire qu’en moins de dix ans, presque chaque bureau disposait de son propre fax.
Cela nous indique le premier élément à savoir au sujet des économies d’échelle du côté de la demande : il y a peu d’incitations à être le premier à adopter une technologie avec cette caractéristique.
La seconde chose à savoir est que, si deux versions de ce type de technologie sont en concurrence, celle qui réussit à attirer le plus grand nombre d’utilisateurs va avoir un avantage, même si l’autre est moins chère ou meilleure. Pour le comprendre, prenons de nouveau l’exemple de la guerre des formats vidéo entre Sony et JVC.
Le format Betamax de Sony était supérieur au format VHS de JVC, tant sur le plan de la qualité de l’image que du son. Cependant, au début des années 1980, Sony fit l’erreur stratégique de limiter la durée d’enregistrement à 60 minutes. Si les consommateurs voulaient utiliser leur nouveau Betamax de Sony pour enregistrer un film, ils avaient besoin de changer de cassette au milieu de l’enregistrement. Au moment où Sony a étendu la longueur de ses cassettes à 120 minutes, il y avait déjà tellement plus d’utilisateurs de VHS que Betamax fut condamné à disparaître.
- concurrence de type « le vainqueur rafle tout »
- Les premières entreprises à entrer sur un marché parviennent souvent à capter tout le marché, au moins temporairement.
La guerre des formats vidéo et son issue représentent un exemple de concurrence où le vainqueur remporte toute la mise et dans laquelle les économies d’échelle en matière de production ou de distribution donnent un large avantage concurrentiel à l’entreprise détenant la plus grande part de marché. Une concurrence dans laquelle le vainqueur remporte toute la mise ne sélectionne pas nécessairement la meilleure alternative.
Afin de comprendre le fonctionnement de ce type de concurrence, la Figure 21.10 représente une situation fondée sur le cas de Sony et JVC. La longueur de l’axe des ordonnées est le nombre de personnes achetant soit le Betamax de Sony, soit la VHS de JVC. Nous faisons l’hypothèse que le prix des deux produits est identique.
Pour simplifier notre exemple, supposez que la valeur d’utilisation du produit pour un nouvel utilisateur est environ égale au nombre d’individus qui utilisent déjà ce produit, n, multiplié par un indice de qualité du produit, q. Le bénéfice net d’acheter un bien est ainsi égal au bénéfice retiré de l’utilisation du produit, qn, moins le prix payé par le consommateur, p. Nos hypothèses simplificatrices nous permettent d’écrire la valeur nette de l’achat du produit comme Π = qn – p. Les produits de meilleure qualité ont une valeur plus élevée de q, de telle sorte que les consommateurs ayant le choix entre deux produits ayant le même nombre d’utilisateurs et vendus au même prix préféreront celui de meilleure qualité.
Le nombre d’utilisateurs achetant un Betamax est mesuré de la gauche vers la droite, partant de 0 et pouvant s’étendre à l’ensemble du marché. La ligne bleue montre le bénéfice net d’utiliser Betamax pour les consommateurs. Son équation est ΠB = qBnB − p, où l’exposant « B » est pour Betamax. Si tout le monde achète Betamax, la valeur pour chaque acquéreur est montrée sur la figure, ΠBmax, qui est égale à qBntotal − p. Si personne n’achète Betamax, la valeur pour le premier acquéreur est négative et égale au prix payé, représenté par l’intersection avec l’axe des ordonnées à gauche, sous l’axe des abscisses.
Sur la même figure, la valeur nette du produit VHS de JVC est dépeinte par la ligne rouge dont l’équation est ΠV = qVnV − p (où l’exposant « V » désigne VHS). Parce qu’il n’y a que deux entreprises, le nombre de personnes achetant VHS est simplement la taille totale du marché, moins le nombre de personnes achetant Betamax.
Supposez que le format Betamax soit de meilleure qualité. Dans notre modèle, cela veut dire que qB > qV. Cela implique que si tout le monde achetait Betamax, la valeur nette serait plus grande que si tout le monde achetait au format VHS, c’est-à-dire que ΠBmax > ΠVmax. Dans la Figure 21.10, ceci est illustré par le fait que la hauteur de la ligne bleue de Betamax là où elle intersecte l’axe de droite (tout le monde utilise Betamax) est plus élevée que l’intersection de la ligne rouge de VHS avec l’axe de gauche (tout le monde utilise VHS).
La première chose à noter est que, si à un moment particulier tout le monde achète VHS (point B), alors un nouvel utilisateur préférera certainement VHS à Betamax. Pour voir cela sur la figure, regardez à gauche et imaginez un nouvel acheteur. Pour cette personne, la valeur de VHS est élevée (le point d’intersection avec l’axe de gauche), et la valeur de Betamax est négative. En effet, le nouvel utilisateur aurait à payer le prix du magnétoscope Betamax, mais n’aurait aucun bénéfice car il n’y aurait pas d’autres utilisateurs. Cela est vrai, bien que nous ayons fait l’hypothèse que le produit de Sony coûtait aussi cher que le produit de JVC et que Betamax était la cassette de meilleure qualité.
- verrou
- Une conséquence des effets externes de réseau qui créent une concurrence du type « le vainqueur rafle tout ». Le processus concurrentiel résulte en une situation difficile à modifier, même si les utilisateurs de la technologie considèrent qu’il existe une innovation alternative supérieure.
La seconde leçon à retenir de cette figure est que, même si un grand nombre de consommateurs (mais inférieur à 4 000) achetait Betamax, un nouveau consommateur préférerait quand même VHS (la ligne rouge est toujours au-dessus de la ligne bleue en ce point). Pour que Betamax casse le monopole de VHS, il lui faudrait au moins 4 000 acheteurs. Dans ce cas, Betamax (plutôt que VHS) serait le produit le plus intéressant et il pourrait capturer l’ensemble du marché (au point A).
Ainsi le gagnant n’est pas nécessairement le meilleur choix. Cela est parfois désigné comme un effet de verrouillage (lock-in, en anglais).
Mais ce n’est pas tout. L’histoire de l’innovation dans une économie de la connaissance est remplie de situations plus compliquées, dans lesquelles des changements ont constamment lieu, pour de nombreuses raisons.
Par exemple :
- Guerre des navigateurs Internet : quand Internet devint populaire, le marché pour les navigateurs Internet était dominé par un produit appelé Netscape Navigator. Il fut remplacé par Internet Explorer de Microsoft dans la « guerre des navigateurs » au début des années 2000. Internet Explorer, à son tour, a ensuite été concurrencé par Mozilla Firefox et Google Chrome.
- Smartphones : au début de l’année 2009, les smartphones Android avaient une part de marché de 1,6 %, les iPhone d’Apple 10,5 %, le marché étant dominé par une technologie appelée Symbia avec 48,8 % de parts. Au début de l’année 2016, 84,1 % des smartphones vendus utilisent Android, les smartphones d’Apple ont acquis une part de marché de 14,8 %, tandis que les smartphones Symbia ne sont plus fabriqués.
- Réseaux sociaux : en juin 2006, 80 % des personnes qui utilisaient un réseau social utilisaient un site appelé Myspace. Depuis mai 2009, plus de gens utilisent Facebook que Myspace.
Question 21.4 Choisissez la ou les bonnes réponses
La Figure 21.8 montre les courbes de coût pour une entreprise produisant un bien intensif en connaissances.
Le coût marginal est constant à 1 $ pour tous les niveaux de production Q. D’après ces informations, laquelle de ces affirmations est correcte ?
- Avec un coût de première copie positif (disons F) et des coûts marginaux constants (Cm), le coût moyen (CM) sera toujours plus élevé que le coût marginal d’une quantité F/Q, comme CM = CT/Q = (F + (Cm × Q))/Q = (F/Q) + Cm.
- Avec un coût de première copie positif (disons F) et des coûts marginaux constants (Cm), le coût moyen (CM) sera toujours plus élevé que le coût marginal d’une quantité F/Q, comme CM = CT/Q = (F + (Cm × Q))/Q = (F/Q) + Cm. Dès lors, CM > Cm pour toutes les valeurs de Q et donc la courbe CM sera toujours descendante. Ainsi, la production de l’entreprise présentera toujours des économies d’échelle.
- Une entreprise produisant un bien intensif en connaissances doit compenser son coût de première copie et donc facturer un prix plus élevé que son coût marginal. Elle ferait des pertes si son prix était plus faible que le coût moyen.
- Une petite entreprise de nettoyage de voitures auraient de très petits coûts fixes initiaux – simplement le coût de l’équipement pour nettoyer les voitures – et presqu’aucun coût de formation. Il y a peu de chance qu’elle bénéficie d’économies d’échelle.
21.5 Marchés (bifaces) d’appariement
Un marché est un moyen de faire se rencontrer des individus qui pourraient bénéficier de l’échange d’un bien ou service. Souvent, il s’agit d’acheteurs et de vendeurs potentiels d’un même bien, comme le lait, et les deux côtés de ce marché sont les fermiers offrant le lait et les consommateurs de lait. Dans la vie de tous les jours, un marché peut également être un lieu, comme le marché aux poissons de Fulton que nous avons décrit dans l’Unité 8, ou un lieu où ceux qui vendent des légumes frais, du fromage et des aliments cuisinés se rassemblent, sachant qu’ils vont y rencontrer des consommateurs potentiels. Sur ces marchés, il importe peu aux acheteurs de savoir qui a produit le poisson ou le lait qu’ils ont acheté. De la même manière, les vendeurs ne se soucient pas de savoir qui va acheter, du moment que quelqu’un achète.
Marchés (bifaces) d’appariement
- marché d’appariement
- Un marché qui apparie des membres de deux groupes distincts d’individus. Chaque personne sur le marché bénéficierait du fait d’être mise en relation avec le bon individu de l’autre groupe. Connu également sous le terme : marché biface.
On utilise également le terme de marché pour décrire un autre type de connexion, dans laquelle les agents de chaque côté du marché font attention à la personne avec laquelle ils sont appariés de l’autre côté. C’est ce que les gens ont en tête lorsqu’ils parlent du « marché du mariage », par exemple. La plupart d’entre nous ne se marient pas de la même manière qu’ils achètent une bouteille de lait dans un magasin. Sur le marché du mariage, il s’agit de se marier avec la personne ayant la combinaison de caractéristiques que l’on trouve être la plus désirable chez un époux ou une épouse. Nous appelons de tels marchés des marchés d’appariement ou des marchés bifaces.
Dans notre vidéo « Économiste en action », Alvin Roth, un économiste spécialiste de la manière dont les marchés sont conçus (et qui a gagné le prix Nobel pour son travail sur le sujet en 2012), explique comment les marchés bifaces fonctionnent.12 13
Nous avons récemment observé une prolifération des plateformes internet qui connectent des individus de deux groupes, en commençant par le lancement en 1995 d’eBay, permettant des transactions de consommateur à consommateur. Ces plateformes conçoivent des technologies grand public qui permettent aux participants de bénéficier d’une structure en réseau et sont des exemples de marchés bifaces.
Airbnb constitue un autre exemple : c’est un service qui connecte des voyageurs cherchant une location d’appartement de court terme et des propriétaires cherchant à gagner de l’argent en rendant leur logement disponible lorsqu’ils ne l’occupent pas. Airbnb est donc une plateforme qui met en contact le groupe des locataires potentiels avec le groupe des propriétaires d’appartements qui voudraient offrir leur appartement contre un loyer. Tinder fait la même chose pour les individus cherchant un rendez-vous pour la soirée. Un service appelé JOE Network met en relation des employeurs avec des individus ayant récemment obtenu un doctorat en économie.
Le projet CORE est lui-même un marché d’appariement, car il offre une plateforme numérique aux chercheurs, aux enseignants et aux étudiants en économie pour entrer en contact de manière mutuellement bénéfique, bien que ce ne soit pas vraiment un marché puisque les services des chercheurs qui procurent le contenu de l’eBook et l’eBook lui-même soient libres d’accès.
Ces plateformes d’appariement sont devenues importantes en économie, en raison de l’ampleur des connexions en réseau qui sont maintenant possibles. Cependant, bien que des connexions à cette échelle soient maintenant faisables techniquement parlant, il n’existe pas de mécanisme permettant de créer à coup sûr des marchés bifaces, même si cela entraînerait des gains pour les participants des deux côtés.
À leurs débuts, ces marchés – c’est-à-dire la création de la plateforme ou toute autre chose permettant de connecter les individus – font face au problème de « l’œuf et la poule ». Réfléchissez au cas d’Airbnb : la plateforme gagne de l’argent en récoltant une commission sur chaque transaction effectuée. À moins qu’il n’y ait un grand nombre de personnes cherchant un appartement sur le site, un propriétaire cherchant à louer n’aurait aucune raison de mettre son appartement sur le site. Sans appartements à louer, Airbnb ne serait pas capable de gagner de l’argent et il n’y aurait pas d’incitations à créer la plateforme en premier lieu.
Un modèle de marché d’appariement biface
- compléments stratégiques
- Pour deux activités A et B : plus A est réalisé, et plus les bénéfices de réaliser B seront élevés, et plus B est réalisé, et plus les bénéfices de réaliser A seront élevés.
En économie, ces deux activités – chercher un appartement en allant sur le site d’Airbnb et poster une offre concernant son appartement sur la plateforme – sont appelés des compléments stratégiques. Ce terme signifie que plus la première activité (recherche) a lieu, plus la seconde (poster) rapportera des bénéfices à celui qui la réalise. De même, plus il y aura d’annonces postées, plus la recherche sera profitable. Cela est très proche des externalités de réseau typiques d’une nouvelle innovation, et que nous avons étudiées dans la section précédente, où l’intérêt d’utiliser Betamax augmentait avec le nombre d’individus qui utilisaient ce format vidéo. Cependant, dans le cas présent, le bénéfice externe dépend du nombre de membres du groupe opposé qui sont sur la plateforme, et non pas seulement du nombre total de personnes qui l’utilisent.
La Figure 21.11a illustre le problème de « l’œuf et la poule ». Nous commençons par le nombre d’annonces postées sur Airbnb. Les individus postent leur annonce parce qu’ils pensent que beaucoup de personnes cherchant un appartement la verront et loueront le leur. Si il y a peu de personnes (cherchant un appartement) se connectant au site de Airbnb, alors peu de propriétaires penseront que cela vaut la peine de poster une annonce sur le site.
La courbe des « annonceurs » montre hypothétiquement combien d’appartements seraient proposés en réponse à chaque nombre possible de personnes cherchant un appartement qui consultent le site. Comme illustré par la figure, si moins de 500 personnes cherchent un appartement sur le site, aucun propriétaire ne proposera son domicile à la location. Pour voir cela, regardez là où la courbe labellisée « Personnes proposant un appartement » intersecte l’axe des abscisses. Quand le nombre de personnes cherchant un appartement sur le site dépasse 500, un nombre croissant de propriétaires vont poster leur offre. Mais il y a une limite au nombre de personnes voulant louer leur domicile temporairement, si bien que la courbe de l’offre devient plus plate lorsque l’on se déplace vers la droite.
La situation est similaire pour ceux qui cherchent à louer un appartement : le nombre de personnes qui consultent Airbnb dépend du nombre d’appartements mis en ligne. Tant qu’il y a plus qu’un nombre minimal d’appartements sur le site (d’après la figure, plus de 200), alors certaines personnes chercheront un appartement ici. C’est l’ordonnée à l’origine de la courbe de la demande. La courbe labellisée « Personnes cherchant un appartement » montre que plus il y a d’appartements en ligne, plus il y aura de personnes qui regarderont.
Pour comprendre comment le marché Airbnb fonctionne, réfléchissez au point Z sur la figure. Z est un résultat mutuellement cohérent dans le sens où :
- Sachant qu’il y a 700 annonces d’appartements, il y aura 1 800 personnes cherchant un appartement.
- Sachant qu’il y a 1 800 personnes cherchant un appartement, il y aura 700 annonces d’appartements.
Cela veut dire que les comportements des annonceurs et des demandeurs sont mutuellement cohérents au point Z et que le point Z est donc un équilibre de Nash. Si le marché est au point Z, avec 700 annonces et 1 800 personnes cherchant un appartement, ni les annonceurs, ni les personnes cherchant un appartement ne voudront changer leur comportement.
Remarquez cependant que deux autres points ont également cette propriété de cohérence mutuelle :
- Il y a un équilibre de Nash pour lequel il n’y a pas d’Airbnb : au point O, personne ne poste d’annonce sur Airbnb de telle sorte qu’il n’y a pas d’incitation à consulter le site, et parce que personne ne consulte le site, il n’y a pas d’incitation à mettre en ligne une annonce pour un appartement ici. C’est le problème de « l’œuf et la poule ».
- Le point A est un résultat mutuellement cohérent, avec 250 appartements en ligne et 600 personnes cherchant des appartements : il y a cependant peu de chances qu’il perdure, pour les raisons que nous décrivons ci-dessous.
Pour voir ce qu’il se passe dans ce dernier cas, supposez que le nombre de personnes cherchant un appartement chute inexplicablement de 600 à 450. La meilleure réponse pour les 250 propriétaires qui avaient mis en ligne une annonce pour leur appartement serait alors de quitter le marché. Si tous les annonceurs quittent le marché, les 450 personnes cherchant un appartement restantes vont également quitter le marché à terme. Ainsi, si nous entrons la zone bleue, un « cercle vicieux » où les annonceurs comme les demandeurs abandonnent le marché va se mettre en place, et le résultat sera de n’avoir pas de marché du tout, ce qui est dénoté sur le diagramme par le point O.
- équilibre instable
- Un équilibre est instable s’il y a, suite à un choc le perturbant, une tendance à s’éloigner encore plus de l’équilibre.
- point de bascule
- Un équilibre instable à la frontière entre deux régions caractérisées par des mouvements différents d’une variable. Si la variable prend une valeur d’un côté, elle bouge dans une direction ; de l’autre côté, elle bouge dans l’autre direction. Voir également : bulle des prix des actifs.
Ce processus d’ajustement qui s’éloigne d’un équilibre est similaire à l’exemple que vous étudié dans l’Unité 11 à propos des prix de l’immobilier et de la valeur des actifs durables. Parce qu’une petite déviation depuis le point A entraîne un processus cumulatif qui éloigne davantage du point A, nous qualifions ce point d’instable. Une situation comme le point A est parfois décrite comme un point de bascule.
Étant donné le problème de « l’œuf et la poule », comment Airbnb a-t-il pu commencer un jour ? Le point Z est un équilibre de Nash, mais comment le marché a-t-il pu arriver là ?
Si un nombre suffisant de demandeurs (plus de 600) arrivaient sur le site, alors plus de 250 propriétaires mettraient en ligne leur appartement sur le site. Ou si par chance, 300 propriétaires mettaient en ligne leur appartement, alors plus de 600 demandeurs voudraient consulter le site d’Airbnb.
La Figure 21.11b montre que dans ces cas-là, un cercle vertueux où des demandeurs comme des annonceurs entrent sur le marché se mettra en place, si bien que le nombre de chaque groupe augmentera jusqu’à ce qu’il y ait 700 annonceurs et 1 800 personnes cherchant un appartement.
Cette figure explique pourquoi nous pourrions aussi bien nous retrouver sans marché, ou avec un marché fonctionnel qui apparie une partie des 1 800 demandeurs avec les 700 annonceurs. Pour voir que ce dernier cas est préférable au premier, pensez à une transition en particulier : tous ceux qui mettent une annonce en ligne et tous ceux qui cherchent un appartement le font volontairement, si bien qu’ils doivent tous voir un bénéfice personnel à le faire. Quand une personne cherchant un appartement est appariée avec un annonceur, tous les deux en bénéficient (sinon ils n’y consentiraient pas). Cela est vrai pour tous les participants du marché. Ainsi, avoir un marché doit être mieux que de ne pas en avoir.
La figure montre également que le marché pourrait naître et persister si d’une façon ou d’une autre nous commencions avec plus de 600 personnes à la recherche d’un appartement ou 250 annonceurs. Mais c’est un sacré si.
Défaillances de marché sur les marchés d’appariement
Le défi en termes de politiques économiques est de trouver un moyen permettant d’assurer la création de plateformes qui génèrent assez de bénéfices pour les participants afin d’en justifier le coût. Cela est parfois assuré par le secteur public qui joue un rôle dans la création des plateformes, comme il l’a fait dans le cas d’Internet, ou des places de marché physiques dans les villes et les villages. Cependant, dans de nombreux cas (comme Airbnb, Tinder, et de nombreuses autres plateformes), l’existence d’un marché biface est le résultat hasardeux d’une personne avant-gardiste ayant eu à la fois l’idée et les ressources pour lancer un projet ambitieux et risqué.
Par exemple, pour résoudre le problème de « l’œuf et la poule » au commencement du marché d’Airbnb, les créateurs de la plateforme auraient pu payer les 250 premiers annonceurs pour qu’ils mettent en ligne leur appartement, leur donnant ainsi une incitation à poster sur le site même si personne ne le consultait. Cela aurait pu initier le cycle vertueux des nouvelles personnes, cherchant et proposant un appartement, rejoignant le marché.
Une stratégie classique des entreprises pour résoudre le problème de « l’œuf et la poule » est de ne rien faire payer, ou très peu, à un groupe d’utilisateurs afin d’attirer l’autre groupe. Par exemple, Adobe vous laisse télécharger son lecteur de PDF gratuitement. Si de nombreuses personnes lisent des documents sous format PDF, cela incite les créateurs de documents à payer pour Adobe Acrobat, le logiciel utilisé pour créer des fichiers PDF.
Certains marchés bifaces, comme Wikipédia, ne sont pas conçus pour réaliser du profit, mais la plupart le sont. Et ceux qui réussissent à créer des plateformes largement utilisées gagnent énormément d’argent. En 2017, Facebook était évalué à 245 milliards de dollars et Mark Zuckerberg (son créateur) possède 28,4 % de l’entreprise.
Ces rentes d’innovation, contrairement à celles associées avec une nouvelle innovation technique comme la machine à tisser étudiée dans l’Unité 2, ne peuvent pas être éliminées par la concurrence car des concurrents potentiels font face au même problème de « l’œuf et la poule » que celui résolu par les innovateurs à succès.
Ce problème est analogue à l’interaction stratégique entre Plugcar et Netflex étudié plus tôt dans l’unité. Il y a probablement de nombreux marchés bifaces potentiellement mutuellement bénéfiques qui n’existent pas (ou pas encore) en raison du problème de « l’œuf et la poule ». Par exemple, il y a eu très peu de nouvelle concurrence dans le secteur des cartes de crédit. Il serait difficile de persuader des commerçants d’accepter un nouveau type de carte si peu d’acheteurs en ont, et il serait difficile d’encourager des acheteurs à avoir un nouveau type de carte qui ne soit pas accepté par beaucoup de vendeurs.
Inventaire de politiques publiques
Les trois sections précédentes ont introduit trois raisons pour lesquelles la concurrence sur les marchés pour obtenir plus de profits ne peut pas créer par elle-même un processus d’innovation efficace : externalités (de réseau), biens publics et économies d’échelle. Les politiques publiques peuvent encourager les innovations utiles et accélérer leur diffusion à tous les utilisateurs qui peuvent en bénéficier. Nous avons déjà mentionné le rôle de coordination possible des standards mis en place par les pouvoirs publics.
Dans les trois prochaines sections, nous allons étudier deux autres politiques publiques :
- Les droits de propriété intellectuelle : ces politiques publiques favorisent les rentes d’innovation reçues par les innovateurs à succès.
- La subvention de l’innovation : ces politiques publiques offrent, directement ou indirectement, de la recherche fondamentale et une dissémination à moindre coût de l’information.
Exercice 21.6 Comprendre les marchés d’appariement
Regardez la vidéo « Économiste en action » d’Alvin Roth. En vous appuyant sur la vidéo, répondez aux questions suivantes :
- En quoi les marchés d’appariement sont-ils différents des marchés des matières premières ?
- Pourquoi un marché pouvant permettre des améliorations au sens de Pareto pourrait néanmoins ne pas exister ? Expliquez comment le programme « New England » a permis de résoudre un problème de « marchés répugnants ».
- Quels sont les aspects de la relation entre acheteurs et vendeurs qui peuvent être une source de défaillance de marché dans les marchés d’appariement ?
Exercice 21.7 Pourquoi les courbes du modèle des marchés d’appariement sont-elles ascendantes ?
Expliquez pourquoi les deux courbes du modèle des marchés d’appariement indiqué dans la Figure 21.11a sont ascendantes. (Indice : souvenez-vous que le fait de poster des appartements (l’offre) et de rechercher des appartements (la demande) sont des compléments stratégiques).
Exercice 21.8 Mauvais assortiment de ceux qui postent et de ceux qui recherchent dans un modèle de marché d’appariement
Imaginez que, pour une raison quelconque, il y ait 1 850 personnes qui recherchent et 750 annonceurs dans le modèle des marchés d’appariement de la Figure 21.11a. Trouvez ce point sur la figure. Comment le nombre d’annonceurs répondrait-il au nombre de personnes cherchant un appartement ? Comment le nombre de demandeurs répondrait-il au nombre d’annonceurs ? Où (à quel point) le marché se déplacerait-il, et pourquoi ?
Exercice 21.9 « L’œuf et la poule »
Des plateformes comme Airbnb, Uber, YouTube et eBay ont résolu le problème de « l’œuf et la poule » mentionné dans le texte plus haut.
- Choisissez l’une des plateformes susmentionnées. Quels gains cette plateforme offre-t-elle, et quels autres marchés a-t-elle bouleversés ?
- Quels facteurs permettent à cette plateforme de bouleverser les marchés existants ?
Question 21.5 Choisissez la ou les bonnes réponses
La Figure 21.11a représente un marché hypothétique pour AirBnB, un service qui met en contact des voyageurs cherchant une location d’appartement de courte durée et des propriétaires cherchant à louer leur domicile pendant qu’ils n’y sont pas.
D’après ces informations, laquelle de ces affirmations est correcte ?
- Les nombres sont inversés : il n’y a pas d’annonceurs quand il y a moins de 500 chercheurs d’appartement et pas de chercheurs d’appartement quand il y a moins de 200 annonceurs.
- Il y a bien trois équilibres de Nash, aux points O, A et Z. Deux sont stables (O et Z), et un est instable (A).
- Pour un nombre de chercheurs d’appartement entre 500 et 600, et un nombre d’annonceurs entre 200 et 250, il y aura un processus de spirale à la baisse où les nombres des deux côtés du marché sont ramenés à zéro, atteignant l’équilibre de Nash où l’activité est nulle (point O).
- Il y a initialement des chercheurs d’appartement et des annonceurs qui ne peuvent trouver un appariement, et qui quitte donc le marché. Après un certain temps, le marché atteint un équilibre (point Z) où tous les chercheurs d’appartement et les annonceurs bénéficient de leur présence sur le marché.
21.6 Droits de propriété intellectuelle
La protection des brevets peut ne pas être nécessaire pour un innovateur si le secret est possible ou si les normes sociales empêchent la copie. La formule du Coca-Cola est demeurée secrète pendant cent ans. L’entreprise affirme qu’à tout moment, elle n’est connue que par deux dirigeants, qui ne voyagent jamais dans le même avion. Le plat typique d’un chef n’est pas un secret, mais les normes sociales entre chefs font que le coût de la copie d’une recette sans permission est extraordinairement élevé. Les humoristes volent rarement les blagues des autres pour la même raison.
Dans d’autres cas, une innovation peut être connue, mais des barrières à la copie peuvent être établies dans le produit lui-même. La technologie du tatouage numérique a (brièvement) permis à quelques distributeurs de musique de créer des enregistrements musicaux qui ne pouvaient pas être copiés. Les entreprises de semences ont fait de même en introduisant des céréales et d’autres variétés hybrides qui ne peuvent pas bien se reproduire.
Les entreprises peuvent également compter sur des compétences supérieures qui peuvent être complémentaires à un produit technologique pour protéger leurs rentes d’innovation. De telles compétences peuvent être une meilleure force de vente, la capacité à amener des produits sur les marchés plus rapidement ou des contrats exclusifs avec les fournisseurs de facteurs de production.
Le secret, les barrières à la copie ou les compétences complémentaires peuvent ne pas être efficaces contre des concurrents qui arrivent à inventer le même produit indépendamment ou qui arrivent, par ingénierie inversée, à comprendre comment il a été produit en partant du produit fini.
- brevet
- Un droit de propriété exclusive d’une idée ou d’une invention, qui dure sur un intervalle de temps spécifique. Durant cette période, le brevet permet à son propriétaire d’être un monopoliste ou son usager exclusif.
- marque déposée
- Un logo, un nom, ou un modèle déposé typiquement associés à un droit d’en exclure l’utilisation par des tiers afin d’identifier leurs produits.
- droit d’auteur
- Droit de propriété sur l’utilisation et la distribution d’un produit original.
Pour de nouvelles idées étant à la fois codifiables (elles peuvent être écrites) et non exclusives (l’imitation ne peut pas être évitée), les États ont créé des lois protégeant les droits de propriété intellectuelle. Il y a de nombreux types de propriété intellectuelle, mais les plus couramment utilisés sont les brevets, les marques déposées et les droits d’auteur. Ils ont en commun de donner à celui qui les détient le droit exclusif de la chose couverte par le droit pendant une période donnée. En termes économiques, la propriété intellectuelle fait de son détenteur un monopoliste temporaire.
Droits de propriété intellectuelle
Les idées codifiables et non exclusives peuvent être protégées de plusieurs manières :
Brevets
Les brevets nécessitent que l’innovateur révèle son idée dans la demande de brevet, qui est examinée par un bureau des brevets, puis publiée. Si les examinateurs sont convaincus que l’idée est suffisamment nouvelle et inventive, ils vont accorder un brevet à l’innovateur. Dans la plupart des cas, un brevet donne à l’innovateur le droit d’attaquer en justice les imitateurs pendant vingt ans : cette durée peut être étendue à vingt-cinq ans dans le cas des brevets pharmaceutiques. Quelques pays ont d’autres durées pour la protection des brevets.
Marques déposées
Une marque déposée donne au propriétaire d’un logo, d’un nom ou d’un modèle enregistré le droit d’exclure d’autres personnes désirant l’utiliser pour identifier leurs produits. Les marques déposées peuvent être étendues indéfiniment dans le temps. Les brevets et les marques déposées sont en général enregistrés dans une agence spécifique.
Droits d’auteur
Le droit d’auteur donne à l’auteur d’un travail intellectuel, tel qu’un livre, un opéra ou un code de logiciel le droit d’exclure d’autres personnes de ses reproduction, adaptation et vente. Le droit d’auteur n’est en général pas enregistré. L’auteur doit affirmer qu’il pense que son droit a été violé. Les durées de droits d’auteur sont beaucoup plus longues que celles pour les brevets et ont été étendues progressivement. Le droit d’auteur s’applique pour un minimum de vingt-cinq ans et est actuellement aux États-Unis de soixante-dix ans après la mort du créateur. De longs droits d’auteur sont sujets à controverse, car le bénéfice va souvent à des personnes qui n’ont pas créé l’œuvre.
Comment les droits de propriété intellectuelle influencent l’innovation
Jusqu’à récemment, on pensait que les brevets encourageaient le développement et l’usage des innovations. Aujourd’hui, les économistes et les historiens réexaminent la question, afin de déterminer si les droits de la propriété intellectuelle promeuvent ou détruisent l’innovation. La réponse varie selon l’importance relative de ces deux effets :
- Création d’un monopole : cela a un effet positif pour le détenteur du droit de propriété intellectuelle, et crée des profits économiques (rentes d’innovation) qui stimulent la R&D.
- Entrave à l’innovation et à la diffusion de nouvelles idées : ces droits limitent la capacité des autres à copier l’innovation.
Un exemple historique important est celui de la machine à vapeur, qui a été si important dans le contexte de la Révolution industrielle. Plusieurs types de machines à vapeur furent inventées au cours du 18e siècle, mais celle ayant rencontré le plus de succès fut brevetée en 1769 par James Watt. Il était ingénieur et ne fit rien pour commercialiser son invention. En fait, il ne commença la production à grande échelle que six ans après.
La valeur commerciale de cette invention était secondaire pour Watt. Le commercial Matthew Boulton acheta alors une partie du brevet et persuada Watt de déménager à Birmingham (l’un des centres de la Révolution industrielle) pour développer le nouvel appareil qu’il avait inventé. Boulton négocia aussi avec succès l’augmentation de la période du brevet de quatorze à trente et un ans.
Licence Creative commons
Le texte de CORE que vous êtes en train de lire est disponible sous ce qui est appelé une licence Creative Commons.
- Elle permet à chacun d’accéder à nos ressources d’enseignement, de les copier et de les utiliser à des fins non commerciales, tant que CORE est désigné comme étant le créateur.
- Nous faisons cela afin que le plus de personnes possible puissent accéder gratuitement au travail de notre équipe, sans en retirer de profits.
Par la suite, Watt et Boulton utilisèrent les tribunaux à de nombreuses reprises pour empêcher toute autre machine à vapeur d’être vendue, même si elle avait une conception différente de celle de Watt. Parmi elles se trouvait l’invention de son rival Jonathan Hornblower, qui était plus efficace que la machine de Watt. Watt et Boulton attaquèrent en justice le brevet de Hornblower et gagnèrent leur procès en 1799.
Une autre invention supérieure, créée par un employé, fut bloquée quand Watt et Boulton arrivèrent à élargir leur brevet pour couvrir le nouveau modèle, même s’ils n’avaient joué aucun rôle dans son développement. Ironiquement, Watt savait comment rendre sa machine plus efficace mais ne pouvait pas réaliser cette amélioration : quelqu’un d’autre en détenait le brevet.
Pendant la durée du brevet Watt-Boulton, le Royaume-Uni augmenta la puissance de son stock de machines à vapeur d’environ 750 chevaux par an. Dans les trente années qui suivirent son expiration, plus de 4 000 chevaux par an de machines à vapeur furent installés en Angleterre. L’efficacité énergétique, qui n’avait pas évolué pendant la durée du brevet, fut multipliée par 5 entre 1810 et 1835.
Il ne fait aucun doute que la protection des brevets est essentielle au processus de création de nouvelles connaissances dans certains secteurs. Quand le brevet d’un médicament pharmaceutique à succès (correspondant à un médicament aux ventes annuelles excédant 1 milliard de dollars aux États-Unis) expire, les entreprises spécialisées dans la copie de formules médicales et dans la vente de versions génériques peuvent entrer sur le marché, le prix du médicament diminuant alors du fait de la concurrence au niveau des prix. Les profits du propriétaire du brevet diminuent de manière significative. Cela montre que des monopoles créés par des brevets peuvent avoir une valeur immense pour le propriétaire du brevet, mais être très coûteux pour les consommateurs de l’innovation brevetée.
Quand le DVD fut introduit sur le marché, on s’aperçut rapidement que la technologie n’allait pas seulement permettre aux consommateurs de posséder, mais aussi de copier de la musique et des films à partir de ces disques de haute qualité. Cela posa un dilemme très important pour les secteurs du film et de la musique. Ce dilemme fut résolu par de nouvelles législations rendant illégal le piratage des systèmes de gestion de droits numériques (GDN) que les entreprises cinématographiques utilisaient pour empêcher les individus de copier des contenus sans permission. Ces mêmes lois sont maintenant souvent utilisées lorsque des consommateurs partagent du contenu protégé par le droit d’auteur via Internet. Aujourd’hui, la technologie GDN aide à protéger les entreprises que l’on appelle maintenant « fournisseurs de contenus » et qui utilisent Internet comme un moyen de distribution – pensez, par exemple, à une entreprise de télévision qui diffuse en direct des événements sportifs sur des ordinateurs et des téléphones portables.
La Figure 21.12 est une représentation schématique du processus d’innovation. Les flèches représentent des facteurs de production, qui pointent vers les aspects de l’innovation qu’ils influencent. Cette figure met en avant le fait que la création de nouvelles connaissances s’appuie toujours sur des connaissances existantes. Par exemple, Hornblower s’est appuyé sur les plans de Watt et Boulton pour améliorer son efficacité. Comme ce fut le cas dans les premiers jours de la Révolution industrielle, les brevets existants limitent les possibilités de s’appuyer sur les connaissances existantes et peuvent ainsi avoir un effet délétère sur l’innovation. D’un autre côté, en offrant des rentes d’innovation aux créateurs, ils encouragent l’innovation.
Quand Petra Moser, une historienne de l’économie, étudia le nombre et la qualité des inventions techniques exposées lors des expositions technologiques du milieu du 19e siècle, elle trouva que les pays disposant de systèmes de brevets n’étaient pas plus innovants que les pays qui n’en avaient pas. La présence de brevets, en revanche, avait un impact sur les types d’activités innovantes dans lesquelles les pays étaient spécialisés.
Quand les économistes ne sont pas d’accord Droits de propriété intellectuelle : moteur ou frein ?
Rappelez-vous que dans une de nos vidéos « Économiste en action », F. M. Scherer soutenait que les brevets incitaient les entreprises pharmaceutiques à investir en R&D (à la différence de nombreux autres secteurs, selon lui) et à poursuivre le développement de nouveaux médicaments phares.
Petra Moser explique que la protection du droit d’auteur des opéras italiens du 19e siècle a conduit à la création d’opéras plus nombreux et mieux écrits. Mais elle présente également des données suggérant que les droits de propriété intellectuelle peuvent faire plus de mal que de bien dans le processus d’innovation s’ils sont trop étendus ou d’une durée excessive.14 15
Exercice 21.10 Thomas Jefferson
Thomas Jefferson (1743–1826), le troisième président des États-Unis, remarqua la nature particulière et merveilleuse d’une idée :
Son caractère particulier (…) est que personne n’en possède moins qu’un autre, car chacun en possède le tout. Celui qui reçoit une idée de moi reçoit lui-même une instruction sans diminuer la mienne ; de même que celui qui allume sa chandelle avec la mienne reçoit de la lumière sans m’assombrir. (« Thomas Jefferson à Isaac McPherson », Writings, 1813)
Jefferson poursuivait en déclarant quelque chose qui, déjà à l’époque, fut controversé :
Il serait alors curieux qu’une idée, la fugitive fermentation d’un cerveau individuel, puisse (…) être revendiquée au titre d’une propriété stable et exclusive.
Selon lui, accorder à un individu le droit exclusif de posséder et d’exclure d’autres personnes de l’utilisation d’une idée ne faisait aucun sens, pas plus qu’il ne ferait de sens pour une personne de refuser de dire à quelqu’un l’heure qu’il est.
- Réécrivez la première partie de la citation de Jefferson en utilisant les termes économiques appris dans ce cours.
- Êtes-vous d’accord avec le propos de Jefferson suggérant que les idées ne devraient pas « être revendiquée[s] au titre d’une propriété stable et exclusive » ? Expliquez votre réponse.
Exercice 21.11 Comment le droit d’auteur a amélioré les opéras italiens et dans quelle mesure ce type de protection doit être limité
Regardez notre vidéo « Économiste en action », dans laquelle Petra Moser s’intéresse aux droits d’auteur des opéras italiens du 19e siècle.
- Identifiez la question de recherche de Petra Moser et le raisonnement qu’elle emploie pour y répondre.
- Quelles sont ses conclusions sur les brevets et la protection des droits d’auteur ?
- Quels facteurs les pouvoirs publics devraient-ils prendre en compte lorsqu’ils déterminent la période d’application des droits de propriété intellectuelle, comme les brevets ou les droits d’auteur ?
Exercice 21.12 Droits de propriété intellectuelle
Pourquoi une extension des droits d’auteur (par exemple l’extension de la durée de protection) n’a-t-elle pas d’impact sur les incitations à améliorer la production intellectuelle (textes et opéras) à l’inverse de l’introduction des droits d’auteur eux-mêmes ? Dans votre réponse, interrogez-vous sur l’identité des bénéficiaires des clauses de droit d’auteur étendues.
Question 21.6 Choisissez la ou les bonnes réponses
Laquelle de ces affirmations concernant les lois de protection de la propriété intellectuelle est correcte ?
- Les brevets sont enregistrés et concédés après un examen du bureau des brevets. Le droit d’auteur est le droit non-enregistré d’empêcher le public de reproduire le travail de tout un chacun.
- Cette affirmation concerne les brevets et le bureau des brevets. L’attribution de droit d’auteur ne demande aucun examen.
- C’est la définition d’une marque déposée.
- Bien que les droits de propriété intellectuelle existent dans le but de protéger les revenus issus d’une innovation technologique, ils peuvent également mettre un frein à l’innovation lorsque la nouvelle connaissance se fonde sur une vieille connaissance déjà protégée par des droits de propriété intellectuelle. Les économistes ne s’accordent pas sur les conditions selon lesquelles les droits de propriété intellectuelle détruisent ou promeuvent l’innovation.
21.7 Brevets optimaux : équilibrer les objectifs d’innovation et de diffusion
Les brevets nous posent un problème économique : comment équilibrer au mieux les objectifs concurrents de faire bon usage de la connaissance existante, en consacrant suffisamment de ressources économiques et de créativité à la production de nouvelles connaissances et en diffusant la nouvelle connaissance ainsi créée ? Un « brevet optimal » est un brevet qui permet d’utiliser au mieux une connaissance dans l’économie. À l’heure actuelle, les accords passés dans le cadre de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) qui régule le commerce international peuvent empêcher certains pays de choisir la durée de leurs brevets mais étant donné la liberté complète de choix, comment un décisionnaire public pourrait-il déterminer la durée d’un brevet optimal ?
Dans la Figure 21.13, nous examinons d’abord la décision d’un innovateur du panneau supérieur. Suivez l’analyse de la Figure 21.13 pour comprendre la chronologie des coûts et des bénéfices de l’innovation et voir qui en profite.
Sur le graphique inférieur de la Figure 21.13, nous incluons les bénéfices, pour le reste de l’économie, qui sont tirés de l’innovation. Du point de vue de l’innovateur, quand le brevet tombe dans le domaine public, il subit une baisse considérable de profits. Mais sur le graphique inférieur nous observons l’effet opposé – les bénéfices de l’innovation grimpent en flèche lorsque le brevet expire parce que l’on peut désormais diffuser librement l’innovation dans l’économie.
Cela illustre le compromis. Sans l’innovation, il n’y a pas de bénéfices pour les autres et la probabilité d’innovation augmente avec des brevets plus longs. Cependant, les bénéfices de tout type d’innovation se réduisent en fonction de la durée d’un brevet. Une imitation rapide de l’innovation entraîne des bénéfices pour l’économie dans son ensemble, illustrés par le rectangle en pointillé dans la figure inférieure.
À partir de là, nous pouvons voir qu’un brevet long augmente les bénéfices d’une innovation rapide et qu’un brevet court augmente les bénéfices d’une innovation rapide. Cependant, en regardant uniquement la Figure 21.13, nous ne pouvons pas déterminer la durée optimale d’un brevet.
Compromis entre les bénéfices de la diffusion et les bénéfices de l’invention
- courbe d’iso-bénéfices
- Les combinaisons de la probabilité d’innovation et des bénéfices totaux pour la société tirés de l’innovation d’une entreprise qui génèrent les mêmes bénéfices totaux.
La Figure 21.14 montre la manière dont nous pouvons représenter les bénéfices de l’innovation pour la société dans son ensemble. Sur l’axe des abscisses se trouvent les bénéfices totaux pour les autres acteurs de l’économie si l’entreprise innove. Nous les appelons B. Sur l’axe des ordonnées, nous estimons la probabilité d’innover, appelée pI. Les courbes décroissantes sont des courbes d’indifférence appelées courbes d’iso-bénéfices. Les bénéfices totaux de l’innovation sont calculés ainsi :
\[\begin{align*} \text{total des bénéfices pour les autres} &= \text{probabilité d'innovation} \\ &\times \text{bénéfices pour les autres si l'entreprise innove} \\ &= p^I B \end{align*}\]Invention et diffusion possible
Quelles sont les contraintes ? Quelles sont les limites aux bénéfices totaux qui surviennent en cas d’innovation ? La réponse à cette question va dépendre de la durée des brevets, car une période plus longue de protection des brevets va au moins au début augmenter la possibilité de l’innovation, pI, mais réduire les bénéfices totaux pour les autres, B, si l’innovation survient grâce au délai de copie.
Même s’il n’y a pas de brevet, l’innovation peut survenir comme on le voit sur l’axe des ordonnées de la Figure 21.15. L’innovateur peut alors profiter de rentes d’innovation uniquement en étant le premier sur le marché, puisque les concurrents ont besoin d’un peu de temps pour le rattraper.
La Figure 21.15 montre que lorsque la durée du brevet augmente (vers la droite le long de l’axe des abscisses), la probabilité de l’innovation augmente également car les rentes d’innovation sont protégées sur une plus longue période. À partir d’une certaine durée de protection, cependant, la probabilité d’innovation commence à décliner car des brevets de long terme vont empêcher d’autres innovateurs potentiels d’utiliser les connaissances ou procédés protégés pour développer une idée.
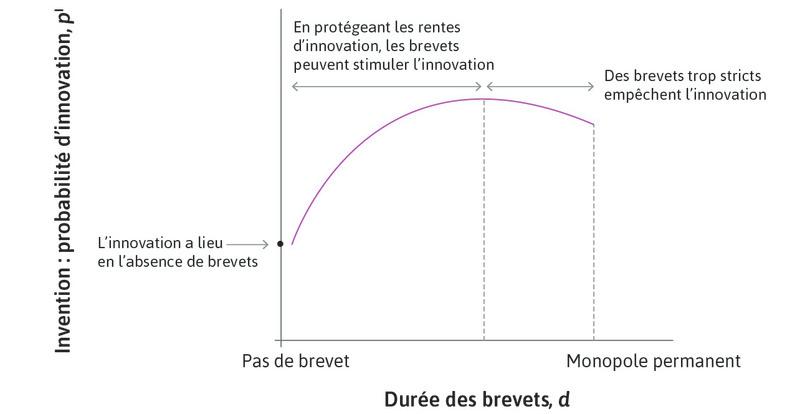
Figure 21.15 Durée de brevet et probabilité d’innovation.
Nous pouvons montrer l’ensemble des possibles sur la Figure 21.16 qui représente le compromis entre une plus grande probabilité d’innovation et les bénéfices totaux pour les autres si l’entreprise innove.
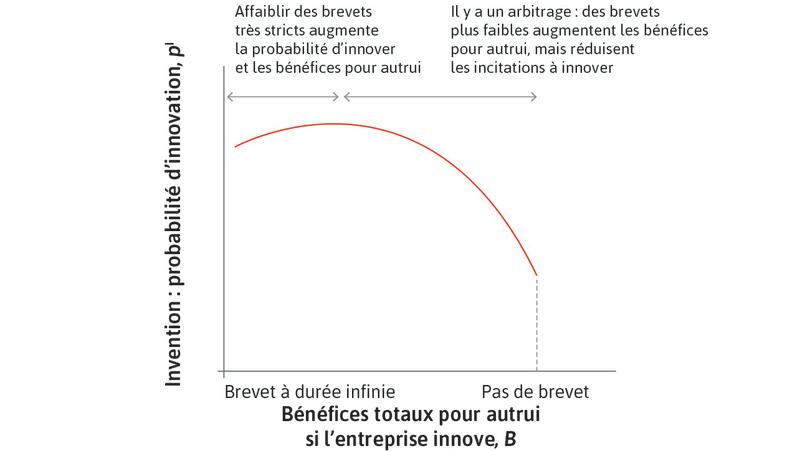
Figure 21.16 Ensemble des possibles : probabilité d’innovation et bénéfices pour le reste de l’économie.
Chaque point sur la frontière de l’ensemble des possibles est le résultat d’une durée donnée du brevet, partant de la gauche avec un brevet qui n’expire jamais. En allant vers la droite, la durée du brevet diminue. Les bénéfices sont croissants pour les autres acteurs de l’économie s’il y a innovation (comme nous l’avons vu sur la Figure 21.15). C’est pourquoi la première partie de la frontière de l’ensemble des possibles est croissante. Cependant, comme nous l’avons également vu, à partir d’un certain moment une contradiction va émerger : une réduction supplémentaire de la durée du brevet va diminuer la probabilité d’innover, même si cela augmente les bénéfices totaux qui résulteraient en cas d’innovation. Cette contradiction explique la portion décroissante de la frontière de l’ensemble des possibles.
Durée optimale des brevets
Si nous étudions maintenant simultanément l’ensemble des possibles et les courbes d’iso-bénéfices, nous pouvons déterminer la durée des brevets qui maximiserait les bénéfices espérés en tenant compte des contraintes imposées par le compromis entre les incitations à l’innovation et à la diffusion. Le niveau le plus élevé possible des bénéfices totaux est représenté par le point de tangence de la courbe d’iso-bénéfices avec l’ensemble des possibles. Il s’agit du point A sur la Figure 21.17.
Ce résultat n’est pas une politique en lui-même mais il nous permet d’en déterminer une. Nous pouvons maintenant nous reporter à la Figure 21.15 et nous demander quelle durée de brevet fixerait un décideur public pour que l’entreprise innovante choisisse la probabilité d’innovation optimale pour la société, p*. La solution est indiquée sur la Figure 21.18.
Exercice 21.13 Brevets optimaux
- Choisissez deux technologies différentes. Pour l’une, le gouvernement choisirait de manière optimale un brevet de courte durée. Pour l’autre, il choisirait plutôt un brevet de longue durée. Dans chaque cas, dessinez l’ensemble des possibles et labellisez le point optimal comme sur la Figure 21.17. Faites l’hypothèse que les courbes d’iso-bénéfices sont identiques.
- La durée des brevets et des droits d’auteur a augmenté de façon continue depuis la Révolution industrielle. Expliquez pourquoi, et argumentez s’il s’agit d’une bonne ou d’une mauvaise chose.
- Comment les organismes publics en charge des brevets devraient-ils réagir si des entreprises essayaient de conserver des monopoles de brevet en brevetant des versions améliorées de la technologie initiale à une date ultérieure ? (Cette technique de prolongation de la durée des brevets est décrite dans le Journal of Health Economics par C. Scott Hemphill et Bhaven N. Sampat.)
Question 21.7 Choisissez la ou les bonnes réponses
La Figure 21.13 représente les coûts et les rentes associés à l’innovation pour l’inventeur et les autres.
D’après ce diagramme, laquelle de ces affirmations est-elle correcte ?
- Le diagramme montre qu’il y a une période pendant laquelle l’innovation n’est pas copiée malgré une absence de brevet, ce qui permet à l’innovateur de récupérer une partie (ou l’ensemble) des coûts causés par l’innovation.
- Comme le montre la figure, les profits du propriétaire du brevet reviennent au niveau des profits économiques nuls dès son expiration.
- Le diagramme montre un bénéfice modeste mais positif aux autres pendant la durée du brevet.
- En ce qui concerne la surface de la zone, les bénéfices perdus des autres sont visiblement plus larges que les bénéfices acquis par l’innovateur.
Question 21.8 Choisissez la ou les bonnes réponses
Le diagramme suivant représente la probabilité d’innover lorsque la durée des brevets est rallongée.
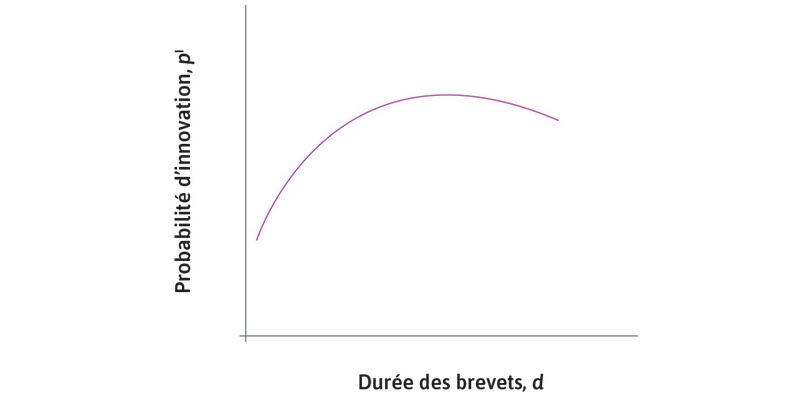
D’après ces informations, laquelle de ces affirmations est-elle correcte ?
- L’intersection positive sur l’axe des ordonnées implique que l’innovation a lieu même en l’absence de brevets.
- Ce n’est évidemment pas le cas, comme le montre le graphique. À un certain moment, les brevets de plus long terme vont empêcher des innovateurs potentiels d’utiliser des connaissances déjà brevetées pour des innovations futures.
- Vrai. La courbe est décroissante parce que ces deux effets vont dans des directions opposées. Sur les points situés à droite du sommet, le caractère désincitatif de l’innovation, causé par les brevets empêchant d’autres innovateurs d’utiliser la connaissance, l’emporte sur l’effet incitatif positif résultant de l’augmentation des rentes d’innovation.
- La durée optimale des brevets dépend de la probabilité de l’innovation ainsi que des bénéfices totaux de l’innovation pour les autres (qui diminuent en fonction de la durée de brevet). Ainsi, la durée optimale se trouve à gauche du point maximal de probabilité.
21.8 Financement public de la recherche fondamentale, de l’éducation et des infrastructures pour l’information
Les avantages et les inconvénients des différents types de droits de propriété intellectuelle ne sont qu’un aspect de la conception d’un système d’innovation efficace. Un autre aspect important est le rôle de l’État. Souvenez-vous, par exemple, de l’introduction de cette unité évoquant des cas où les bénéfices attendus sur les marchés de la diffusion des téléphones portables ne se sont pas matérialisés parce que les infrastructures publiques nécessaires – principalement des routes et des moyens de transport – faisaient défaut. La fourniture publique des biens et des services, comme les routes qui auraient permis aux fermiers indiens de bénéficier de leur nouvel accès à l’information sur les prix, est essentielle à la diffusion des bénéfices de l’innovation. Comme nous allons le voir, les origines de l’ordinateur et, par extension, la révolution de l’information tout entière rendent essentiel le rôle de l’État dans le processus d’innovation lui-même.
Des politiques publiques adaptées pour l’innovation peuvent principalement aider de deux façons :
- En accélérant le rythme de l’innovation : cela a lieu par des interventions ayant trait au soutien de la recherche fondamentale et des infrastructures de communication, à l’établissement de standards, ainsi qu’à la conception des brevets, des droits d’auteur et des marques déposées.
- En influençant la direction de l’innovation : cela facilite la production de nouvelles idées qui ont des applications environnementales, pédagogiques, médicales ou autres avec une dimension sociale.
Recherche financée par l’État
Les origines de la révolution des technologies de l’information se retrouvent dans la construction des premiers ordinateurs électroniques après la Seconde Guerre mondiale, bien que, comme dans toute technologie, certains éléments soient plus anciens. Charles Babbage mit tout d’abord au point un ordinateur sous la forme de la machine à différences dans un article publié en 1822 (le gouvernement britannique aida à financer son développement) et son idée aida Ada Lovelace à développer le premier programme pour ordinateur.
Les efforts des gouvernements britannique et nord-américain pendant et après la Seconde Guerre mondiale permirent l’éclosion de machines électroniques programmables. Aux États-Unis, l’objectif initial reposait sur le développement de systèmes de missiles, puis se porta sur le Projet Manhattan visant à développer la bombe atomique. Ces projets nécessitaient d’effectuer un nombre considérable de calculs rapides, aussi bien pour la balistique que pour prévoir les réactions atomiques. L’argent du gouvernement américain servit à financer des groupes privés, tels que les Bell Labs dans le New Jersey et des centres de recherche fédéraux comme Los Alamos.
Un partenariat étroit s’est alors établi entre le secteur privé, les organismes publics et les universités menant à la construction de la machine ENIAC en 1946 sous l’égide de l’armée américaine. Il s’agissait du premier ordinateur électronique, mais il ne pouvait pas stocker de programmes. D’autres innovations suivirent rapidement, comme le développement du transistor par William Shockley aux Bells Labs en 1948 et la création de nouvelles entreprises comme Fairchild Semiconductor. Le soutien du gouvernement américain à ce secteur s’est poursuivi via un financement de la recherche, permettant notamment la création d’Internet (en 1969) dans le cadre d’un projet financé par la DARPA, l’agence pour les projets de recherche avancée de défense américaine.
Au Royaume-Uni, les premiers progrès dans le domaine informatique furent concentrés à Bletchley Park, où le mathématicien Alan Turing travailla sur le déchiffrage du code allemand Enigma. La machine Colossus qui y fut développée resta secrète jusqu’aux années 1970, mais les scientifiques et ingénieurs de Bletchley Park continuèrent leur travail avec la construction en 1948 du premier ordinateur d’après-guerre pouvant stocker des programmes, appelé Baby, à l’Université de Manchester, une autre institution publique. Le développement commercial des ordinateurs suivit rapidement, effectué par des entreprises comme Ferranti.
Ce modèle de financement de la recherche initiale par l’État, via des organismes publics incluant l’armée ou via les universités, qui est suivi par des applications commerciales, est courant. À l’instar des industries informatiques et électroniques, Internet et le World Wide Web (créé par Tim Berners-Lee au laboratoire de recherche du CERN financé par un consortium de pays), les secteurs de la pharmacie et des biotechnologies modernes, ainsi que les applications commerciales de nouveaux matériaux tels le graphène, trouvent tous leur origine dans la recherche fondamentale et un développement initial financé par les pouvoirs publics. Les écrans tactiles et la souris d’ordinateur sont également le résultat d’une recherche financée par les pouvoirs publics aux États-Unis.16
Le format MP3 fut créé par un petit groupe de chercheurs dans un laboratoire public de recherche en Allemagne, appartenant à la Fraunhofer-Gesellschaft. Leur brevet permet de diviser la taille des fichiers audio par un facteur de 12, tout en maintenant la qualité sonore. Cette innovation rendit possible le partage de musique via Internet et contribua à un bouleversement mondial majeur dans l’industrie musicale. Les entreprises commerciales ne l’ont pas tout de suite adoptée, mais le format s’est largement diffusé car ses créateurs réagirent en distribuant des logiciels d’encodage aux utilisateurs pour un faible coût et n’attaquèrent pas les hackers qui les rendaient disponibles gratuitement.
Mariana Mazzucato, une économiste spécialiste des causes et des conséquences de l’innovation, utilise l’exemple de quelques innovations numériques fondamentales, telles qu’Internet, le GPS et les écrans tactiles, pour montrer que l’État joue un rôle essentiel dans le financement de la recherche et des start-ups technologiques. Elle ne voit pas seulement l’État comme un acteur chargé de s’occuper des activités dont le marché ne s’occupe pas, par exemple lorsque les rendements sont trop éloignés dans le futur et incertains, mais aussi comme un acteur capable de décider à quels types d’activité le secteur privé devrait s’intéresser. Selon elle, les investissements stratégiques du gouvernement américain aident à expliquer la domination des entreprises américaines dans les secteurs de haute technologie, incluant le numérique et les biotechnologies.
Compétitions et récompenses
Une politique publique de soutien à l’innovation assez différente consiste à attribuer un prix pour le développement réussi d’une solution à un problème posé, solution qui répondrait à certains critères spécifiques. Le lauréat du prix est récompensé pour le coût du développement, en lieu et place de l’attribution d’un monopole sur la nouvelle idée ou méthode, et l’innovation tombe ainsi directement dans le domaine public.
Par exemple, à la suite du désastre du pétrolier Deepwater Horizon, la Fondation XPrize a offert 1 million de dollars à l’équipe qui parviendrait à améliorer significativement les technologies existantes pour le nettoyage des marées noires. En moins d’un an, une équipe a développé une méthode qui a quadruplé l’efficacité du nettoyage par rapport aux performances habituelles du secteur.
Un exemple encore plus connu est l’invention par le fabricant de montres John Harrison du chronomètre de marine, un appareil qui a permis, pour la première fois, de mesurer de manière (raisonnablement) précise la longitude d’un bateau en mer. Harrison commença à travailler sur son chronomètre en 1730, en réponse à l’attribution en 1714 d’un prix (environ 2,5 millions de livres sterling, en prix de 2014) par le gouvernement britannique pour l’invention d’un appareil permettant de mesurer la longitude. L’approche d’Harrison reposa sur la construction d’une horloge précise et assez petite pour être emmenée en mer, afin de pouvoir déterminer l’heure de Greenwich à laquelle le soleil atteint son zénith. Le problème avait attiré certains des plus grands esprits de l’époque, notamment Isaac Newton. Harrison proposa plusieurs méthodes, chacune meilleure que la précédente, mais un désaccord apparut entre lui et le gouvernement sur la question du gain monétaire, mérité ou non. En effet, la solution d’Harrison était assez différente de celle attendue par le gouvernement. Il reçut finalement une série de plus petites sommes au fil des années.
Aujourd’hui, le Prix Longitude est financé par le gouvernement britannique. Étonnamment, le Comité Longitude qui attribue le prix a demandé au public de choisir six défis auxquels il pourrait attribuer la dotation du prix.
L’un de ces défis est le problème de la résistance aux antibiotiques que nous avons mentionné dans l’Unité 12, un choix que de nombreux experts approuveraient. C’est intéressant car beaucoup de personnes sont sceptiques quant à la capacité des organismes publics à sélectionner des causes dans lesquelles investir en R&D. L’Histoire est pourtant traversée de décisions d’investissement technologiques plutôt bonnes pendant et après la Deuxième Guerre mondiale.
Si vous croyez que la société civile est plus à même d’identifier les problèmes les plus urgents, alors le Comité Longitude a pris la bonne décision en nous laissant choisir.
Un autre exemple dans lequel les compétitions sont efficaces est la création de prix pour le développement réussi de médicaments pour des maladies négligées. Ces médicaments traitent des maladies répandues dans certaines parties du monde où il y a peu d’innovations pharmaceutiques car le marché privé est limité du fait des très faibles revenus de ceux qui souffrent de ces maladies.17
Exercice 21.14 Recherche financée par l’État
- Quels sont les arguments pour et contre des investissements publics directs dans l’application commerciale de nouvelles technologies ?
- Décrivez les différentes manières pour l’État de choisir les technologies dans lesquelles investir pour que le processus soit plus transparent pour les contribuables.
- Pensez-vous qu’associer les contribuables au choix des technologies dans lesquelles investir soit une bonne idée ? Expliquez votre réponse.
- Dans quels types de technologies l’État devrait-il investir plus, selon vous, et dans quels types de technologies devrait-il laisser le secteur privé opérer seul ? Expliquez votre réponse.
Question 21.9 Choisissez la ou les bonnes réponses
Parmi les mesures suivantes, lesquelles favorisent des processus innovants efficaces ?
- Ici, le problème du marché concurrentiel des biens de substitution (comme Betamax de Sony vs. les VHS de JVC) tient au fait que le gagnant rafle toute la mise. Les agences du secteur public devraient plutôt soutenir des accords entre les acteurs de l’industrie en question pour, par exemple, les aider à prendre des décisions sur les nouveaux standards techniques.
- Dans cette situation, des entreprises peuvent hésiter à investir dans une innovation à moins que d’autres entreprises ne soient déjà en train d’investir dans l’innovation complémentaire. Subventionner les facteurs diminue les coûts de l’innovation et augmente la probabilité que des entreprises investissent.
- Un brevet permet à l’inventeur de profiter temporairement du profit de son idée, ce qui pourrait inciter les inventeurs à payer les coûts initiaux élevés de l’innovation.
- La connaissance produite est un bien public par nature, ce qui implique que les entreprises innovantes ne peuvent pas capturer tous les bénéfices générés par leurs innovations. Un système de brevets pourrait apporter une solution à ce problème.
Question 21.10 Choisissez la ou les bonnes réponses
Lesquelles de ces affirmations concernant les politiques publiques de l’innovation sont correctes ?
- C’est exactement le genre d’innovations dans lesquelles l’État devrait investir plutôt que de se reposer sur les entreprises.
- L’État peut avoir des difficultés à réguler les entreprises dont il possède une partie du capital, notamment lors de l’application de politiques de concurrence ou de standards environnementaux.
- Les exemples sont dans le texte.
- Les exemples sont dans le texte.
21.9 Conclusion
Le Royaume-Uni et les Pays-Bas, berceaux du capitalisme et de la Révolution industrielle, ne faisaient pas figure d’exception en termes d’intelligence et de créativité de leurs populations. La Chine, par exemple, était au moins autant, sinon plus créative, ayant développé en premier le papier, l’imprimerie, la poudre à canon, le compas, et littéralement des centaines d’autres innovations importantes. D’autres pays, notamment le Japon, étaient adeptes de l’adaptation et de la diffusion de nouvelles méthodes et idées. Mais la pression combinée des rentes d’innovation et de la concurrence pour survivre, qui était la caractéristique du processus d’innovation et de diffusion du capitalisme, en a fait un système économique au dynamisme unique qui transforma les économies britannique et hollandaise.
Les politiques publiques ont également joué un rôle important. Pour que les innovateurs prennent le risque d’introduire un nouveau produit ou un nouveau processus de production, il est crucial que les rentes d’innovation ne soient pas capturées par le gouvernement ou par d’autres individus. Cela requiert des droits de propriétés protégés par un système juridique fonctionnant correctement, comme cela a été le cas au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et dans d’autres pays qui, tôt, ont connu le coude de la crosse de hockey du revenu par habitant.
Plus récemment, la Sillicon Valley, le système d’innovation allemand ou d’autres exemples d’innovations réussies ont été aidés par les pouvoirs publics fournissant des facteurs de production complémentaires, tels que les infrastructures physiques, la recherche fondamentale et l’éducation publique, et permettant aux innovateurs un monopole seulement temporaire, afin que la concurrence conduise finalement à une réduction des prix.18
Pour résumer, c’est cette combinaison d’incitations privées et de politiques publiques de soutien qui explique pourquoi le capitalisme est un système économique si dynamique. Parmi les conséquences observées dans de nombreux pays, nous avons l’amélioration des niveaux de vie mesurés par le revenu par habitant (rapportée dans l’Unité 1), ainsi que la réduction du nombre d’heures travaillées vue dans l’Unité 3.
Cependant, il est bon de se rappeler que Joseph Schumpeter, l’économiste qui a le plus significativement contribué à notre compréhension actuelle de l’innovation (et que nous avons étudié dans l’Unité 16), désignait le processus de changement technologique par les mots « destruction créatrice ».
Dans cette unité, nous avons mis l’accent sur la partie créatrice : la mise au point de nouveaux procédés et de nouveaux produits qui nous permettent de subsister en passant progressivement moins de temps au travail. Mais dans l’Unité 16, nous avons étudié comment les changements technologiques privent également les hommes de travail et dévalorisent des compétences autrefois établies et bien rémunérées. De surcroît, dans l’Unité 20 nous avons vu que l’extension de la production et la substitution de l’énergie humaine ou animale par l’énergie fossile du fait des progrès technologiques a créé de nouveaux défis environnementaux. Cependant, l’espoir demeure que ces mêmes technologies, encadrées par les bonnes politiques, puissent un jour trouver une solution à ces problèmes.
Les économistes peuvent contribuer à concevoir ces politiques et à évaluer les coûts et les bénéfices des moyens de promouvoir les innovations bénéfiques. Ils peuvent aussi contribuer à résoudre l’aspect « destructeur » des nouvelles technologies.
Concepts introduits dans l’Unité 21
Avant de continuer, revoyez ces définitions :
- Innovation de procédé et innovation de produit
- Innovation radicale et innovation incrémentale
- Innovations comme substituts ou compléments
- Connaissance codifiée et connaissance tacite
- Invention et diffusion
- Systèmes d’innovation (Silicon Valley et Allemagne)
- Coûts du premier exemplaire
- Concurrence où le vainqueur remporte la mise
- Brevets, droits d’auteur, marques déposées
- Économies d’échelle du côté de la demande et externalités de réseau
- Marchés d’appariement (bifaces)
- Durée optimale des brevets
21.10 Références bibliographiques
- Boldrin, Michele, and David K. Levine. 2008. Against Intellectual Monopoly. New York, NY: Cambridge University Press.
- Boseley, Sarah. 2016. ‘Big Pharma’s Worst Nightmare’. The Guardian, Updated 5 February 2016.
- DiMasi, Joseph A., Ronald W. Hansen, and Henry G. Grabowski. 2003. ‘The Price of Innovation: New Estimates of Drug Development Costs’. Journal of Health Economics 22 (2): pp. 151–85.
- Edsall, Thomas B. 2016. ‘Boom or Gloom?’. New York Times. Updated 27 January 2016.
- Engel, Jerome S. 2015. ‘Global Clusters of Innovation: Lessons from Silicon Valley.’ California Management Review 57 (2): pp. 36–65. University of California Press.
- Gordon, Robert J. 2016. The Rise and Fall of American Growth: The US Standard of Living since the Civil War. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Hall, Peter A., and David Soskice. 2001. Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage. New York, NY: Oxford University Press.
- Hemphill, C. Scott, and Bhaven N. Sampat. 2012. ‘Evergreening, Patent Challenges, and Effective Market Life in Pharmaceuticals’. Journal of Health Economics 31 (2): pp. 327–39.
- Janeway, William H. 2012. Doing Capitalism in the Innovation Economy: Markets, Speculation and the State. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jensen, Robert. 2007. ‘The Digital Provide: Information (Technology), Market Performance, and Welfare in the South Indian Fisheries Sector.’ The Quarterly Journal of Economics 122 (3): pp. 879–924.
- Kornai, János. 2013. Dynamism, Rivalry, and the Surplus Economy: Two Essays on the Nature of Capitalism. Oxford: Oxford University Press.
- Koromvokis, Lee. 2016. ‘Are the Best Days of the US Economy Over?’. PBS NewsHour. 28 January 2016.
- Kremer, Michael, and Rachel Glennerster. 2004. Strong Medicine: Creating Incentives for Pharmaceutical Research on Neglected Diseases. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Landes, David S. 2000. Revolution in Time. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Mazzucato, Mariana. 2013. ‘Government – investor, risk-taker, innovator’.
- Moser, Petra. 2013. ‘Patents and Innovation: Evidence from Economic History’. Journal of Economic Perspectives 27 (1): pp. 23–44.
- Moser, Petra. 2015. ‘Intellectual Property Rights and Artistic Creativity’. Voxeu.org. Updated 4 November 2015.
- Mowery, David C., and Timothy Simcoe. 2002. ‘Is the Internet a US Invention?—an Economic and Technological History of Computer Networking’. Research Policy 31 (8–9): pp. 1369–87.
- Roth, Alvin. 1996. ‘Matching (Two-Sided Matching)’. Stanford University.
- Rysman, Marc. 2009. ‘The Economics of Two-Sided Markets’. Journal of Economic Perspectives 23 (3): pp. 125–43.
- Saxenian, AnnaLee. 1996. Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Swarns, Rachel L. 2001. ‘Drug Makers Drop South Africa Suit over AIDS Medicine’. New York Times. Updated 20 April 2001.
- The Economist. 2007. ‘To Do with the Price of Fish’. Updated 10 May 2007.
- Witt, Stephen. 2015. How Music Got Free: The End of an Industry, the Turn of the Century, and the Patient Zero of Piracy. New York, NY: Viking.
-
Swarns Rachel L. 2001. ‘Drug Makers Drop South Africa Suit over AIDS Medicine’. New York Times. Mis à jour le 20 avril 2001. ↩
-
Sarah Boseley. 2016. ‘Big Pharma’s Worst Nightmare’. The Guardian. Mis à jour le 5 février 2016. ↩
-
‘To Do with the Price of Fish’. The Economist. Mis à jour le 10 mai 2007. ↩
-
Robert Jensen. 2007. ‘The Digital Provide: Information (Technology), Market Performance, and Welfare in the South Indian Fisheries Sector’. The Quarterly Journal of Economics 122 (3): pp. 879–924. ↩
-
Peter A Hall, and David Soskice. 2001. Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage. New York, NY: Oxford University Press. ↩
-
Stephen Witt. 2015. How Music Got Free: The End of an Industry, the Turn of the Century, and the Patient Zero of Piracy. New York, NY: Viking. ↩
-
David C Mowery and Timothy Simcoe. 2002. ‘Is the Internet a US Invention? An Economic and Technological History of Computer Networking.’ Research Policy 31 (8-9): pp. 1369–87. ↩
-
Jerome S. Engel. 2015. ‘Global Clusters of Innovation: Lessons from Silicon Valley’. California Management Review 57 (2). University of California Press: pp. 36–65. ↩
-
AnnaLee Saxenian. 1996. Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128. Cambridge, MA: Harvard University Press. ↩
-
Michele Boldrin and David K Levine. 2008. Against Intellectual Monopoly. New York, NY: Cambridge University Press. ↩
-
János Kornai. 2013. Dynamism, Rivalry, and the Surplus Economy: Two Essays on the Nature of Capitalism. Oxford: Oxford University Press. ↩
-
Marc Rysman. 2009. ‘The Economics of Two-Sided Markets’. Journal of Economic Perspectives 23 (3): pp. 125–43. ↩ ↩2
-
Alvin Roth. 1996. ‘Matching (Two-Sided Matching)’. Stanford University. ↩
-
Petra Moser. 2013. ‘Patents and Innovation: Evidence from Economic History’. Journal of Economic Perspectives 27 (1): pp. 23–44. ↩
-
Petra Moser. 2015. ‘Intellectual Property Rights and Artistic Creativity’. VoxEU. Mis à jour le 4 novembre 2015. ↩
-
William H. Janeway. 2012. Doing Capitalism in the Innovation Economy: Markets, Speculation and the State. Cambridge: Cambridge University Press. ↩
-
Michael Kremer and Rachel Glennerster. 2004. Strong Medicine: Creating Incentives for Pharmaceutical Research on Neglected Diseases Princeton, NJ: Princeton University Press. ↩
-
David S. Landes. 2000. Revolution in Time. Cambridge, MA: Harvard University Press. ↩